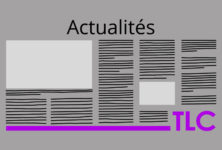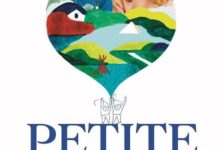Les Prix de Cannes 2019 : une couleur politique qui n’étouffe pas les envies de nouveaux cinémas
A l’issue de la cérémonie de clôture, les Prix de la Compétition cannoise 2019 paraissent témoigner d’une volonté de mettre en valeur les faits politiques mondiaux d’aujourd’hui, en accordant tout de même de la place à des envies de cinémas nouveaux fortes.
A l’issue de Cannes 2019, l’attribution de la Palme d’or à Parasite (notre critique ici) apparaît comme un petit renouvellement : cinéaste globalement culte pour une bonne part des cinéphiles actuels, Bong Joon-ho se plaît souvent à reprendre certains des codes de la pop culture (tels ceux des films de monstre, dans The Host, son célèbre film sorti en 2006). On peut trouver que le fait qu’il gagne la Palme d’or salue l’entrée d’une “façon d’aimer le cinéma”, très actuelle, au sein des plus hautes sphères cannoises.
Bong Joon-ho est un virtuose de la mise en scène : celle de Parasite marque donc, par sa perfection formelle et son imagination. Le cadre social et politique de son film, central, est de surcroît bien traité : ses personnages ne tombent aucunement dans le cliché, et le cri d’alerte quant aux inégalités de société en Corée du Sud arrive à sonner fort. Et de façon plus directe et moins roublarde que dans Burning, film en Compétition à Cannes 2018… Sauf que Parasite apparaît parfois doté d’un scénario mécanique, et semé de quelques effets un peu gratuits. On est en droit de préférer, sur le même modèle, le puissant The Host, son coup d’éclat de 2006, plus ample, plus direct et plus dramatique.
Politique et formes originales
Les prix de la Compétition cannoise 2019 restent marqués par une coloration politique forte, qui n’étouffe pas cependant les essais de forme et les envies de nouveau cinéma : à ce titre, Atlantique de Mati Diop (Grand Prix ; notre critique ici), et son Sénégal marqué par les migrations, où les femmes restées au pays se mettent à basculer dans une autre réalité, et Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles (Prix du jury ex-aequo ; notre critique ici), où la mort frappe façon slasher dans un Brésil miné par la corruption, mêlent leurs messages d’alerte à des partis-pris tranchés.
Ailleurs, la réflexion politique et sociale est servie par un mode plus sec, qui vise à l’ampleur : Le Jeune Ahmed, de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Prix de la mise en scène ; notre critique ici) et Les Misérables, de Ladj Ly (Prix du jury ex-aequo ; notre critique ici) ont recours à de tels outils. Quant à Céline Sciamma, avec Portrait de la jeune fille en feu (Prix du scénario ; critique ici), elle traite l’émancipation féminine en creux, dans un XVIIIe siècle où deux femmes se font face, l’une peignant l’autre et les deux réfléchissant sur leur image qu’elles donnent à voir…
Restent aussi le prix que l’on n’attendait pas du tout, la Meilleure interprétation féminine décernée à l’anglo-américaine Emily Beecham, pour le peu apprécié Little Joe, et le prix qu’on attendait, la Meilleure interprétation masculine allée à Antonio Banderas pour Douleur et gloire, de Pedro Almodovar (critique ici). Banderas – dont on peut trouver qu’il n’est pas le meilleur acteur du film – enfin sacré après une suite de rôles peu brillants aux Etats-Unis… Et aussi, la curieuse Mention spéciale décernée à It must be heaven (critique ici), dans lequel le palestinien Elia Suleiman se montre toujours virtuose mais perd sa réflexion. Tout de même marquée par de l’air nouveau et des envies de nouvelles formes, cette suite de prix cannois s’avère plutôt inspirée, même si on eût bien aimé voir l’excellent, et extrêmement fin Sibyl être récompensé aussi. Un film, comme d’autres précédemment cités, bien au croisement des tons et des formes. Avec une envie de prise de risque.
Geoffrey Nabavian
*
Visuel : © FDC