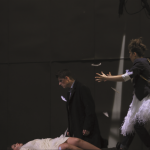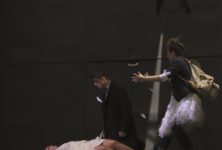A l’Opéra de Dijon, un Orphée et Eurydice qui ne fait pas beaucoup rêver
Première production de l’année 2017 à l’Opéra de Dijon, Orphée et Eurydice de Glück est actuellement produit en écho à l’Orfeo de Monteverdi donné en tout début de saison. La version choisie ici (car il en existe en effet plusieurs, entre la version italienne donnée par exemple à l’Opéra de Lyon en mars 2015 ou encore la version française retravaillée par Berlioz donnée à la Monnaie en 2014) est la version française de 1774. Un choix intéressant mis en scène par Maëlle Poésy qui s’essaie ici pour la première fois à l’opéra. Un coup d’essai qui n’est malheureusement pas un coup de maître…
[rating=2]
La metteur en scène propose un travail qui manque en effet d’originalité avec des idées déjà vues ou du moins, pour les personnes ne fréquentant pas régulièrement les salles lyriques, qui ne surprennent pas. L’époque choisie est celle d’aujourd’hui, dans un décor unique qui permettra d’enchaîner les trois actes sans entracte et sans impression de cassure, ce qui est assez agréable. Cependant, la simplicité reste le maître mot et prend une connotation négative ici, proche de “simpliste” : le mur du fond, qui ne couvre que le tiers central de la scène, est composé de différents rectangles unicolores, de même que le plafond penché. Notons toutefois que l’acoustique difficile de la salle qui nous gène habituellement paraît ici moins désagréable que d’habitude. Probable que le choix de cette forme de décors n’y soit pas étrangère… Outre ce point positif, l’ouverture de certains rectangles ou plateaux pour faire passer de la terre lors de la descente aux Enfers d’Orphée ainsi que l’ouverture du plafond pour laisser descendre les racines imposantes d’un arbre qui semble mort n’apportent malheureusement pas une grande originalité ne de surprise mais une lecture quasi textuelle : le royaume des morts, dit parfois le royaume sous-terrain, se trouve mot pour mot sous terre. Le jeu de lumière particulièrement réussi de Joël Hourbeigt est toutefois à souligner.
Outre le décors composé également de tables et de chaises que les choeurs et danseurs mettent en place au début et à la fin, ainsi que de deux estrades basses sur les côtés, la scène est donc dépourvue d’attrait. Côté réflexion, Maëlle Poésy place Eurydice sur scène durant l’ouverture, nous présentant son mariage avec Orphée, les invités saluant le couple avant que la jeune mariée ne s’écroule, morte sur le sol (notons au passage le jeune femme sautillante et un peu trop enthousiaste qui apporte un caractère presque comique déplacé puisque rien d’autre ne semble aller dans cette direction). Le final de l’opéra, louant les bienfaits d’Amour (personnage sur lequel nous allons revenir) reprend la mise en scène d’ouverture, enfermant l’oeuvre dans un mouvement cyclique. Là aussi, bien que l’idée soit notable et intéressante, l’idée de cycle dans les opéras portant sur ce mythe n’est pas entièrement original : rappelons-nous par exemple l’Orfeo de Rossi vu à Nancy où début et fin se faisaient également écho. Ne soyons pas trop durs cependant : si la (trop) grande simplicité et le manque d’originalité de la mise en scène sont notables, elle n’en reste pas moins des plus accessibles et ne va surtout pas à l’encontre de l’oeuvre, ce qui est à souligner à l’heure actuelle.
Côté voix, Sara Gouzy interprète un Amour qui ne donne malheureusement pas envie d’être amoureux : le jeu beaucoup trop exagéré et maniéré (notamment dans les mouvements des mains) confère au personnage un aspect qui n’a rien de naturel mais rien de divin pour autant. La voix quant à elle est trop sèche, parfois à la limite de la justesse, manquant d’amplitude et de projection. Le stress de la Première et le jeune âge de l’interprète peuvent peut-être expliquer cela. Eurydice est pour sa part chantée par Elodie Fonnard qui, si elle convainc par le jeu, n’apporte toutefois pas de grande satisfaction vocale, laissant là aussi entendre des pointes parfois sans douceur. Enfin, le ténor Anders J. Dahlin campe un Orphée scéniquement très agréable et crédible. La voix particulière, donnant l’impression que la quasi totalité des notes viennent du fond du palais tandis que les graves sont particulièrement veloutées, liant toutes les notes sans rupture, est un atout indéniable et ne peut qu’être apprécié, mais pas à sa juste valeur ici. Nous ne parvenons pas en effet à être transportés, certainement à cause d’un grand nombre d’erreurs dans le texte et d’un manque de projection ou, pour être plus juste, à cause d’une fosse beaucoup trop présente et d’une direction dénuée de sentiment.
Cette dernière, composée de l’Orchestre Dijon Bourgogne et dirigée par Inaki Encina Oyon, ne convainc pas davantage que le reste de la production déjà évoqué. Le chef impose des tempi saccadés, ne convenant pas forcément à l’oeuvre. Paroxysme de cela, l’air tant attendu d’Orphée, “J’ai perdu mon Eurydice”, bâclé à un rythme ne laissant aucune place à l’émotion (qu’il n’est certes pas le seul à adopter). On est bien loin de la magnifique version donnée à Bruxelles avec Stéphanie d’Oustrac et Hervé Niquet! L’émotion semble d’ailleurs bannie de la partition par Oyon qui met en avant la fosse en oubliant ou bien en ne se rendant pas compte que cette dernière empiète de trop sur les voix de la scène qui peinent à se faire entendre dans cette salle à l’acoustique déjà difficile, comme nous l’avons dit plus haut.
Rien de bien transcendant que tout ceci donc, mais il serait injuste de ne pas mentionner le choeur de l’Opéra de Dijon particulièrement brillant ce soir! Superbe projection, belle homogénéité, très bonne diction, jeu paraissant investi, nuance,… Le seul bémol n’est en réalité pas de leur ressort puisqu’il s’agit des terribles “non!” que lancent les créatures infernales voulus à l’origine par Glück presque comme des cris et rendus ici traînants (un autres des choix du maestro). Présents jusqu’aux retrouvailles d’Orphée et Eurydice ainsi qu’à la fin, il est finalement le grand “vaincoeur” de la soirée qu’il parvient à embellir.
©Gilles Abegg