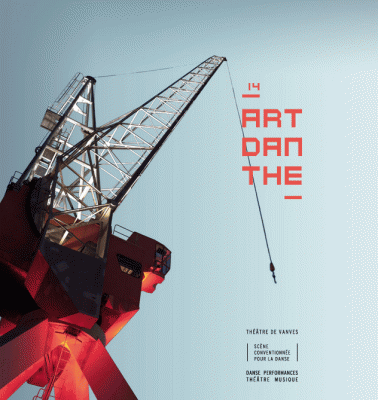
Je pensais vierge mais en fait non : performance de Thibaud Croisy
Collaborateur des Gens d’Uterpan, performeur et auteur, Thibaud Croisy signe dans le cadre du festival Artdanhé un précis de géographie mentale autour d’un lieu de vie et tente de rendre manifestes les traces de vie inscrites entres ses murs.
Une vingtaine de personnes bravent le froid au pied d’un immeuble à la Goutte d’or, dans le 18ème arrondissement. Un homme et une femme arrivent d’un pas hâtif. Le signal est donné. Le groupe les suit à travers une cour intérieure, puis dans l’escalier étroit qui mène, jusqu’au troisième étage, dans un petit appartement parisien.
Le séjour se remplit rapidement et les spectateurs invités à assister à Je pensais vierge mais en fait non tentent de s’effacer contre les murs, éprouvent la brutalité de leur intrusion dans un espace privé. De surcroit, aucun rituel de transition ou d’accueil n’est accompli. Une fois franchi le pas de la porte, nous basculons dans l’espace-temps de la performance, accomplie dans un lieu, malgré le dépouillement du décor, habité ou habitable. Mais le doute et l’inconfort s’installent, car à mieux jauger la pièce, toute trace de vie et tout indice qui pourraient donner des informations quant à l’identité et à la personnalité de l’occupant de cet appartement ont été effacés avec minutie. Et pourtant, quelques détails à vocation indicielle crèvent les yeux : sur la table, des bouteilles de bière vides, une assiette et des couverts, un bout de pain dur et quelques miettes, un cendrier enfin et des mégots. Le dispositif se joue du trouble des frontières entre le décor froid et complètement maitrisé et la vocation première de cet espace de vie.
Chaque action pourrait être l’occasion d’un renversement de perspectives. La fiction interfère, se nourrit même tout autant qu’elle parasite la minutie et le contrôle qui définissent les gestes de la performeuse. Ses moindres mouvements sont simples et pourtant soigneusement écrits. Le regard vide, dans un état de concentration extrême, elle déplace et range avec un soin obsessionnel ces objets selon des règles qui défient la logique du sens commun. Malgré la tension extrême qui le parcourt, le corps de la performeuse semble se dématérialiser peu à peu, devenir translucide et insaisissable, simple support neutre des fictions que les invités projettent à partir de la situation. Avec ces mêmes gestes machinaux, elle va ôter un à un ses vêtements et paradoxalement sa nudité va parachever l’abstraction de son corps. Seul le regard fixe de l’homme cloué sur le canapé semble la faire exister devant nos yeux. Un cd diffuse le récit d’un homme qui évoque, à la première personne, son espace de vie. Cette voix anime et rend sensible une foule de traces de vie inscrites à même les murs, derrière les couches successives de peinture, sur le plancher en bois et dans la configuration des pièces.
L’inscription de cette performance dans une boucle de l’éternel retour amplifie le sentiment de présences invisibles qui saturent et conditionnent l’espace.
Une vingtaine de personnes bravent le froid au pied d’un immeuble à la Goutte d’or, dans le 18ème arrondissement. Un homme et une femme arrivent d’un pas hâtif. Le signal est donné. Le groupe les suit à travers une cour intérieure, puis dans l’escalier étroit qui mène, jusqu’au troisième étage, dans un petit appartement parisien.
Le séjour se remplit rapidement et les spectateurs invités à assister à Je pensais vierge mais en fait non tentent de s’effacer contre les murs, éprouvent la brutalité de leur intrusion dans un espace privé. De surcroit, aucun rituel de transition ou d’accueil n’est accompli. Une fois franchi le pas de la porte, nous basculons dans l’espace-temps de la performance, accomplie dans un lieu, malgré le dépouillement du décor, habité ou habitable. Mais le doute et l’inconfort s’installent, car à mieux jauger la pièce, toute trace de vie et tout indice qui pourraient donner des informations quant à l’identité et à la personnalité de l’occupant de cet appartement ont été effacés avec minutie. Et pourtant, quelques détails à vocation indicielle crèvent les yeux : sur la table, des bouteilles de bière vides, une assiette et des couverts, un bout de pain dur et quelques miettes, un cendrier enfin et des mégots. Le dispositif se joue du trouble des frontières entre le décor froid et complètement maitrisé et la vocation première de cet espace de vie. Chaque action pourrait être l’occasion d’un renversement de perspectives. La fiction interfère, se nourrit même tout autant qu’elle parasite la minutie et le contrôle qui définissent les gestes de la performeuse. Ses moindres mouvements sont simples et pourtant soigneusement écrits. Le regard vide, dans un état de concentration extrême, elle déplace et range avec un soin obsessionnel ces objets selon des règles qui défient la logique du sens commun. Malgré la tension extrême qui le parcourt, le corps de la performeuse semble se dématérialiser peu à peu, devenir translucide et insaisissable, simple support neutre des fictions que les invités projettent à partir de la situation. Avec ces mêmes gestes machinaux, elle va ôter un à un ses vêtements et paradoxalement sa nudité va parachever l’abstraction de son corps. Seul le regard fixe de l’homme cloué sur le canapé semble la faire exister devant nos yeux. Un cd diffuse le récit d’un homme qui évoque, à la première personne, son espace de vie. Cette voix anime et rend sensible une foule de traces de vie inscrites à même les murs, derrière les couches successives de peinture, sur le plancher en bois et dans la configuration des pièces.
L’inscription de cette performance dans une boucle de l’éternel retour amplifie le sentiment de présences invisibles qui saturent et conditionnent l’espace.












