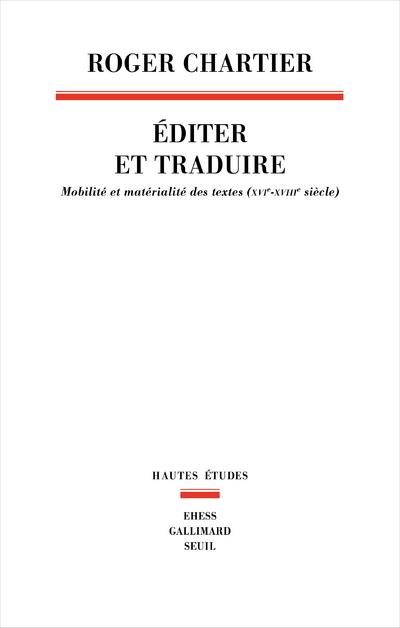
“Éditer et traduire” de Roger Chartier : une invitation à repenser notre approche de la modernité
L’historien de l’édition Roger Chartier publie Éditer et traduire. Mobilité et matérialité des textes (XVIe-XVIIIe siècle). Une invitation à repenser notre approche de la modernité.
Précoce héliotropisme
Les siècles qui s’étendent de la Renaissance aux Lumières nous sont bien connus : ce sont ceux de Castiglione, Shakespeare, Cervantès, Molière ou Voltaire. Des figures que l’on a tendance à relier dans un fourre-tout commun, sans se soucier de la façon dont ces auteurs ont réellement pu s’influencer.
En s’attachant à une sphère géographique qui va de l’Espagne à l’Angleterre en passant par la France et l’Italie, Roger Chartier nous convie à une approche plus subtile de cette période éminemment féconde pour l’histoire des idées et la littérature. Étudier la circulation réelle des textes entre ces différents territoires nous permet ainsi d’éviter certains anachronismes.
En effet, le pôle d’attraction de la Renaissance se situe sans conteste au sud de l’Europe : si les textes espagnols et italiens sont presque immédiatement traduits en français et en anglais, le contraire n’est pas vrai. Et Roger Chartier de nous rappeler qu’il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que Shakespeare soit traduit en français – merci Voltaire ! – , puis en espagnol. L’insularité de la Grande-Bretagne semble alors autant culturelle que géographique.
De la plasticité des œuvres
Par mobilité, nous n’entendons pas ici le seul déplacement d’un livre d’une sphère linguistique à une autre, mais aussi la plasticité de ces œuvres qui, de traduction en adaptation, d’éditions complètes en morceaux choisis, subissent nombre de transformations. Un passionnant chapitre est par exemple consacré aux différentes traductions et réceptions du monologue d’Hamlet.
Pour rendre compte de ces adaptations et inégales circulations des œuvres, l’historien a choisi de consacrer chaque chapitre à l’aventure vécue par un texte fondateur de cette modernité : Baltasar Gracian et son “homme de cour”, Castiglione et son “courtisan”, Molière et son “Don Juan”… et pas moins de trois chapitres sur Shakespeare. Où l’on apprend qu’un auteur anglais avait imaginé une rencontre – pas très paisible – entre le dramaturge anglais et Cervantès.
Un ouvrage érudit, mais accessible, qui nous invite avec bonheur à suivre les pérégrinations de ces premiers best-sellers.
EHESS/Gallimard/Seuil
320 pages – 24 euros
Visuel : couverture du livre













