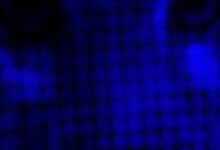Festival Un état du monde: des larmes et des fantômes
Le festival Un état du monde revient au Forum des images pour une neuvième édition. Mettant en parallèle cinéma et questions de géopolitique, le festival propose une sélection d’œuvres qui osent révéler, questionner et critiquer les dessous de leur pays, ses injustices, blessures, espoirs et échecs. Avec cette année des rétrospectives sur le cinéma et la mémoire libanaise, sur l’œuvre des réalisateurs Pablo Larraín et Mohammad Rasoulof, ou encore sur le cinéma afro-américain. Que nous dit le cinéma sur l’état du monde ? Qu’il a comme un goût salé de larmes et que présent et passé, traumatismes et souvenirs, sont forcés d’exister ensemble. Que le monde est peuplé de fantômes, en somme, marques indélébiles de la guerre et de la répression ne demandant pas tant à hanter les nouvelles générations qu’à continuer à exister, et à ne pas se faire oublier.
Tombé du ciel (2016), de Wissam Charaf
Le tombé du ciel, c’est Samir, ancien milicien pendant la guerre civile libyenne, présumé mort depuis 20 ans. Il débarque d’un coup, trébuchant dans le cadre, et s’installe chez son petit frère, Omar, garde du corps à Beyrouth qui va lui-même subir de plein fouet les séquelles de la guerre. Avec Tombé du ciel, sélectionné par l’ACID au festival de Cannes 2016, le jeune réalisateur libanais Wissam Charaf porte un regard décalé sur un pays qui peine à se relever après l’horreur. Ici, les morts ne meurent pas mais reviennent, tout comme le passé. Leur but n’est pas d’effrayer les vivants en faisant claquer des portes ou en secouant leur lit, mais tout simplement de reprendre le cours de leur vie, comme si la guerre n’avait rien effacé. Visuellement très beau, Tombé du ciel choisit donc l’humour pour parler de l’horreur passée et du traumatisme présent. La caméra s’attarde en gros plans sur les visages qui observent impassiblement, sur les corps plantés là, ceux des vivants presque grotesques, ceux des morts portant la marque éternelle de la guerre. Samir apparaît en plein milieu d’une montagne recouverte par la neige, et disparaît en plongeant dans la mer : si l’eau a fondu, et la guerre aussi, lui devra continuer à porter son corps, son fardeau, ses souvenirs, jusqu’à les accepter.
 Entre deux projections, petit passage par l’exposition BD « Le piano oriental », pour découvrir l’œuvre éponyme de la dessinatrice libanaise Zeina Abirached. Une série de planches de sa bande-dessinée, qui rend hommage à un arrière-grand-père inventeur en 1960 d’un nouvel instrument de musique permettant de jouer les quarts de ton de la musique orientale sur un clavier de piano, est à découvrir sur les murs du Forum des images. Ces dessins en noir et blanc, qui ne vont pas sans rappeler ceux de Marjane Satrapi, misent sur la géométrie et la symétrie dans des mouvements de création ou de déconstruction, sortent souvent du cadre comme s’ils reniaient l’idée même de frontière, et transmettent dans l’ensemble un profond désir de mixité au lieu du rejet des différences et de la restriction à l’entre-soi. Une leçon d’amour et d’acceptation de l’autre, d’ouverture sur les autres communautés dans un monde qui a tendance à privilégier l’individualisme et l’exclusion.
Entre deux projections, petit passage par l’exposition BD « Le piano oriental », pour découvrir l’œuvre éponyme de la dessinatrice libanaise Zeina Abirached. Une série de planches de sa bande-dessinée, qui rend hommage à un arrière-grand-père inventeur en 1960 d’un nouvel instrument de musique permettant de jouer les quarts de ton de la musique orientale sur un clavier de piano, est à découvrir sur les murs du Forum des images. Ces dessins en noir et blanc, qui ne vont pas sans rappeler ceux de Marjane Satrapi, misent sur la géométrie et la symétrie dans des mouvements de création ou de déconstruction, sortent souvent du cadre comme s’ils reniaient l’idée même de frontière, et transmettent dans l’ensemble un profond désir de mixité au lieu du rejet des différences et de la restriction à l’entre-soi. Une leçon d’amour et d’acceptation de l’autre, d’ouverture sur les autres communautés dans un monde qui a tendance à privilégier l’individualisme et l’exclusion.
I Am Not Your Negro (2016), de Raoul Peck
Le cinéaste Raoul Peck s’est emparé des écrits d’une de ses idoles, le grand oublié James Baldwin qui fut, dans la seconde partie du XXème siècle, un écrivain prolifique et l’une des voix de la communauté afro-américaine. Sur ces mots forts, visionnaires et capables de décrypter la société américaine en deux ou trois phrases, Raoul Peck a superposé avec talent et intelligence un grand mélange d’images d’archives, publiques et privées, d’extraits de vieux films Hollywoodiens, d’interviews filmées, ou encore d’images contemporaines pour retracer les combats des afro-américains de ces dernières décennies. De l’assassinat de Malcolm X à l’élection de Barack Obama en passant par l’attentat de Birmingham en 1963, son I Am Not Your Negro se révèle être une œuvre poignante, bouleversante, instructive et violente à la fois dans ce qu’elle montre et dénonce et dans le fait qu’elle ait besoin d’exister. Raoul Peck a su combiner sa propre expérience et sa propre vision, qui se traduisent ici par des images, à celles de James Baldwin, qui se traduisent par des mots, réunissant ainsi le visuel et le sonore pour délivrer un message quasi-universel – la vie, l’expérience humaine en tant que personne noire – et porter un regard critique qui dépasse le simple constat de la dualité blancs-noirs mais prouve bien l’échec d’un modèle de société. Ici encore les fantômes imposent leur présence, effrayants car n’ayant pas encore été complètement tués, et réapparaissant même de nos jours avec force, libérés et encouragés par les dernières élections américaines. Raoul Peck le montre bien lorsqu’il met en parallèle des mots prononcés par Baldwin dans les années 1970 et des images datant de 2014, ou lorsqu’il fait se succéder aux visages de noirs lynchés et pendus ceux de Trayvon Martins, Kendra James, Michael Brown, Alton Sterling et tant d’autres.
Visuel: affiche officielle/SR