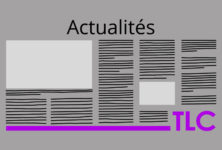Annick Massis, ensorcelante empoisonneuse!
L’opéra Lucrezia Borgia de Gaetano Donizetti est donné en ce moment au Capitole de Toulouse. Annick Massis y fait, une fois de plus, une démonstration éclatante de son art dans le bel canto
Lucrezia Borgia est une œuvre particulière. Pourtant tiré de la pièce éponyme de Victor Hugo, l’opéra de Donizetti s’en distingue, car, pour obéir aux codes de l’opéra romantique, le compositeur et son librettiste durent faire des arrangements que Victor Hugo d’ailleurs réprouva.
Il en ressort un ouvrage hybride dans laquelle une partie de la violence des situations est amoindrie, et ce, alors qu’Hugo voulait mettre « une mère dans un monstre », Donizetti fut contraint d’épargner son héroïne (et de transiger avec la censure).
Comme l’indique Piotr Kaminski, « Dès le premier solo (…), ce n’est pas la monstrueuse Borgia, « la difformité morale la plus hideuse, la plus repoussante, la plus complète » qu’il sera donné d’entendre à l’auditeur, mais une héroïne donizettienne, mélancolique, pathétique, fière et condamnée. »
Cela n’est pas sans conséquence pour la soprano qui doit colorer sa voix différemment, selon qu’elle incarne la mère aimante de Gennaro ou l’empoisonneuse cadette de la famille Borgia.
Le metteur en scène, de son côté, doit réussir à trouver une cohérence sur la longueur, à la fois sur le plan des sentiments et celui de la politique, et donner corps à des personnages plus ambivalents qu’il n’y paraît : une mère qui cherche à protéger son fils tout en semant la mort autour de lui ; ce fils ignorant de sa filiation qui va être balloté entre des émotions contradictoires ; un Duc qui veut détruire Gennaro en raison d’une jalousie primaire causée par les ambiguïtés de sa femme.
Si vous ajoutez à cela une bande de jeunes désœuvrés dont le passe-temps est de se battre et de courir les filles, et qui ne trouvent rien de mieux à faire que de défier la femme la plus dangereuse de la péninsule, vous avez matière à un beau synopsis dramatique, voire mélodramatique dont il faut néanmoins tirer le meilleur pour lui conférer de l’épaisseur.
Malheureusement, la production d’Emilio Sagi n’y parvient pas. Artificiellement intemporelle, souvent triviale, parfois distanciée, elle souffre, de surcroît, d’une direction d’acteurs trop caricaturale pour illuminer des personnages aussi ambigus.
Elle échoue à traduire la violence machiste de la scène des jeunes avec Lucrezia, la spirale d’enfermement physique et psychologique entre la Borgia et son mari, ou la moiteur étouffante des courtisans pris dans la toile d’araignée de la tueuse. Le travail reste d’une esthétique froide et déconcertante, les attitudes et les poses convenues.
Et loin de se concentrer sur le principal, Sagi se paye même le luxe d’ajouter des gadgets comme une ébauche d’homosexualité entre Gennaro et Orsini.
Et c’est dommage ainsi, car si vocalement le plateau tient la route, le chant est en discordance avec ces attitudes et ces gestuelles.
Mert Süngü , en Gennaro, a un organe puissant, pas toujours subtil, mais très efficace. Par ce chant parfois un peu fruste, s’il perd en noblesse, il campe, sans conteste, le jeune être enflammé par lequel le malheur de tous – y compris le sien – va advenir. Il réussit fort bien l’air plutôt dispensable au demeurant, du début du second acte.
Le personnage du Duc pose moins de problèmes, car on est en présence d’un vrai méchant d’opéra mû par des considérations bassement triviales. Quoi qu’un peu courte dans les aigus, la voix de Andreas Bauer Kanabas est belle, assurée et idéale pour la confrontation avec Lucrezia, cette scène clé où, plus adversaires combattants que mari et femme, chacun avec ses armes doit faire plier l’autre, jusqu’à la mort si nécessaire.
Par son écriture et une présence importante dans l’oeuvre, le rôle de Maffio Orsini doit « en mettre plein la vue » ; il est l’organisateur des plaisirs des courtisans, le bouffon à ses heures ; il fait le show notamment dans cette longue et superbe scène finale d’empoisonnement, ponctuée à la fois par les blagues alcoolisées et le glas de la mort qui se rapproche.
Si Eléonore Pancrazzi ne manque pas d’abattage et a une véritable aisance vocale dans le Brindisi du dernier acte, elle reste tout de même un peu sous-dimensionnée pour ce rôle avec une voix pas suffisamment large et plus proche de celle de Chérubin.
Lorsqu’Annick Massis annonça la prise de rôle, on en fut presque surpris et effrayé tant celui-ci est difficile, exigeant pour le souffle, avec des écarts de registre impressionnants et des graves consistants, particulièrement lorsqu’il s’agit de faire passer toute la violence de l’histoire.
La soprano explore, à son rythme, les rôles de Donizetti et celui-ci sonne comme un aboutissement avec ses écueils sur lesquelles bien des divas se sont cassé les dents. Cette gestion intelligente de carrière porte ses fruits ce qui en fait aujourd’hui une des belcantistes les plus accomplies : la technique est imparable, la virtuosité indispensable à Donizetti éclatante et le timbre a gardé une fraicheur stupéfiante.
On connaît néanmoins l’artiste et l’on sait toutefois qu’elle peut avoir parfois du mal à lâcher la bride ce qui peut l’amener à contraindre son chant.
Ce dimanche, si on la sent prudente dans son air d’entrée (d’une lenteur surprenante), le point de bascule de la représentation arrive lorsqu’elle entend faire rendre gorge à son mari où, sans transition, la femme se mue en tueuse et cherche à inverser le rapport de forces. Car Massis, c’est aussi cela ! Ce moment où, par un aigu longuement tenu forte, voire crié, elle va extirper tous ses démons pour devenir la vraie tragédienne qu’un opéra tel que celui-ci l’exige.
Mue par cette belle énergie, le reste de sa prestation nous conduira à une scène finale d’anthologie, stupéfiante, dans laquelle la chanteuse met dans son chant stylistiquement parfait, avec variations et couleurs, toute la rage désespérée d’une mère qui vient de transgresser l’ordre naturel des choses en tuant son fils.
Si l’on met de côté la lenteur désarmante de l’entrée de Lucrezia, la direction de Giacomo Sagripanti, est d’une grande finesse, respectueuse des équilibres et des chanteurs, mais parfois aux dépens de la brillance et de la dynamique indispensable à cette partition.
On retiendra enfin, dans les seconds rôles les excellentes prestations de Thomas Bettinger et de Julien Véronése, deux artistes très prometteurs; et l’on n’omet pas de rappeler, une fois de plus, que les chœurs du capitole sont exemplaires.
Ainsi, la réussite de l’entreprise montre qu’Annick Massis est, et reste, une référence dans le bel canto et que, malgré une carrière moins médiatisée, elle tient parfaitement son rang aux côtés des plus grandes du genre. Comme l’artiste est rare et que ce qui est dit n’est plus à dire, on peut légitimement se poser la question du prochain directeur d’opéra courageux qui lui proposera de reprendre ce rôle ou lui permettra d’aborder un nouveau personnage de Donizetti. Savourons, en attendant, le plaisir qu’elle nous a offert dans cette Lucrezia à Toulouse, et remercions Christophe Ghristi, le maître des lieux, de lui avoir donné cette opportunité et d’avoir ainsi contribué à cette réussite éclatante.
© Patrice Nin et Paul Fourier