« Extrême : Quand le cinéma dépasse les bornes », un essai sur le cinéma d’horreur en demi-teinte
 Les années 2000 ont vu l’émergence d’un cinéma d’horreur dont l’abjection lui a valu d’être qualifié de « torture porn » ou « gornography » (mot-valise à partir de « gore » et « pornography »)… et amènent à sérieusement questionner l’industrie du spectacle et l’état des sociétés contemporaines. Lorsque, loin d’être comme autrefois des films confidentiels, des titres comme Saw ou Hostel, entre bien d’autres, rencontrent d’autant plus de succès qu’ils vont sans cesse plus loin dans la reconstitution d’images de torture et de dégradation d’êtres humains, il est judicieux de se poser des questions sur le sens et les implications d’un tel cinéma. C’est ce qu’a tenté de faire Julien Bétan dans son essai Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes. Cependant, celui-ci manque de hauteur de vue et, si elle ouvre des pistes pertinentes, la réflexion n’élude pas des lieux communs trop attendus.
Les années 2000 ont vu l’émergence d’un cinéma d’horreur dont l’abjection lui a valu d’être qualifié de « torture porn » ou « gornography » (mot-valise à partir de « gore » et « pornography »)… et amènent à sérieusement questionner l’industrie du spectacle et l’état des sociétés contemporaines. Lorsque, loin d’être comme autrefois des films confidentiels, des titres comme Saw ou Hostel, entre bien d’autres, rencontrent d’autant plus de succès qu’ils vont sans cesse plus loin dans la reconstitution d’images de torture et de dégradation d’êtres humains, il est judicieux de se poser des questions sur le sens et les implications d’un tel cinéma. C’est ce qu’a tenté de faire Julien Bétan dans son essai Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes. Cependant, celui-ci manque de hauteur de vue et, si elle ouvre des pistes pertinentes, la réflexion n’élude pas des lieux communs trop attendus.
Julien Bétan connaît son sujet : c’est ce qu’il n’est pas permis de contester. Le long chapelet de références mentionnées est d’ailleurs fort profitable. Sa curiosité, en outre, ne se borne pas au seul domaine de l’horreur : c’est un authentique cinéphile qui s’exprime, non tel quelconque plumitif adulescent à la Mad Movies.
Abordant l’histoire de l’horreur dans le cinéma à travers la notion d’extrême, il privilégie une approche particulièrement intéressante. Le cinéma d’horreur, tout autant que le cinéma pornographique, se définit bien par le franchissement, par le défi aux normes, au bon sens, à la bienséance, à toute norme civilisante. Le cinéma d’horreur est en effet l’espace fictif de la cruauté, de la vengeance, du sadisme – des pulsions les plus « inhumaines » et barbares, donc les plus profondément humaines. Le cinéma d’horreur rend compte d’une inclination anthropologique à la violence et/ou à son détournement dans une représentation fictive. Il fend le fragile masquillage de civilisation, qui soudain ne parvient plus à cacher la face horrible de Thanatos. Le cinéma d’horreur révèle au fond que la civilisation et la barbarie sont moins antithétiques que complémentaires, en tension, la première étant renvoyée à sa fragilité, à son arbitraire, à ses failles, insuffisances, apories.
Il y a, certes, dans le cinéma d’horreur, dans la variété de ses productions, une telle polysémie qu’il est malaisé de faire des généralités. Mais il y a comme une récurrence dans les intentions et les discours qui entourent le cinéma d’horreur, depuis les années 60 : l’ambition de dénoncer des tabous et faire craquer la gangue hypocrite des conventions sociales. C’est d’ailleurs ce à quoi conclut volontiers Julien Bétan : « Ces transgressions revêtent une dimension d’acte de résistance, car leur radicalité les empêche d’être entièrement digérées par le système marchand, d’ordinaire si prompt à récupérer toute tendance nouvelle et à la rendre inopérante (…). Il faut provoquer une rupture, déchirer le voile, donner à voir autrement ». Il énonce ceci en conclusion, en référence aux avant-gardes, notamment en citant le Second manifeste du Surréalisme d’André Breton. Comme si la situation sociale était aujourd’hui comparable aux années 1920 ! Comme si la dynamique des années 1920, où les carcans sociaux et moraux pesaient encore lourdement, avait encore sa pleine pertinence aujourd’hui que les seuls tabous qui demeurent encore, ce sont les tabous eux-mêmes. Voilà pourquoi paraît indéfendable la position consistant à vanter un cinéma détruisant les limites de la bienséance au nom de ce que toute norme serait liberticide. Il est par surcroît absurde d’accréditer la vertu émancipatrice de la provocation, du franchissement, qui a cessé d’être émancipatrice pour devenir un attendu, une surenchère – aussi bien dans la musique que dans le cinéma d’horreur ou le porno – et un argument commercial : toujours plus loin, plus fort, plus vite, plus sale, plus violent, etc. La provocation a été une arme intellectuelle dans un contexte social qui pouvait être étouffant ; elle n’est aujourd’hui qu’un lieu commun, un passage obligé et une forme obligée de divertissement pour une société de blasés désensibilisés.
Or, voilà la limite de l’étude de Julien Bétan : ne pas circonscrire la spécificité anthropologique du temps, ne pas penser le faire société. Comme trop souvent à gauche, la critique est volontiers orientée contre le libéralisme économique, et soutenue par des arguments de libéralisme socio-culturel. Ainsi, de même que les pro-art contemporain se gargarisent des franchissements de tabous, de même le cinéma d’horreur piétine toute limite civilisante au nom d’une certaine idée de la liberté (d’expression), conçue comme illimitation, ce qui dans les deux cas se trouve en parfaite harmonie avec l’illimitation du libéralisme économique. Et ce n’est pas un hasard si, des cadavres plastinés de Günther von Hagens ou des veaux sciés flottant dans le formol de Damien Hirst, à la franchise Saw, l’abjection morbide a un parfum de tiroir-caisse et trouve sa vraie valeur moins dans l’esthétique que dans le mercantilisme.
Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si, comme en art contemporain, l’intentionnalité prime sur l’effet produit. Ainsi, lorsque l’auteur évoque le rôle précurseur de l’Actionnisme viennois, c’est pour y réciter le catéchisme : volonté d’exorciser le vieux démon nazi… sans interroger plus loin la valeur intrinsèque des actions, puis leur perception, ainsi que leur effet réel – mais ceci nous amènerait à discuter la réalité d’un exorcisme ou du chamanisme dans une société non chamanique et dépouillée de ses symboles transcendantaux. En somme, Julien Bétan a ce tort de vouloir penser son époque avec les outils interprétatifs qui dominent celle-ci. Or, pour penser son époque, il est souvent plus judicieux de penser contre celle-ci ou de tenter de penser hors de celle-ci. Puisque Julien Bétan cite Nietzsche, il connaît sans doute ce conseil tiré du Gai Savoir : « Place, entre toi et aujourd’hui, au moins l’épaisseur de trois siècles ! » Voilà ce qui fait défaut ici.
Ainsi donc, lorsqu’il évoque l’incantatoire invocation à la « catharsis », il oublie que la catharsis théorisée par Aristote s’inscrit dans une société extrêmement normée, dans un environnement saturé de symboles, dans une soumission de la polis au cosmos, dans un contexte où la liberté était entendue comme aptitude à l’autonomie (cf. Castoriadis) et non comme illimitation, où les limites étaient condition d’exercice de sa liberté et de sa responsabilité et non pas, comme le croient les libéraux, ces fanatiques de l’illimitation, comme entrave à la liberté. Il est toutefois à noter qu’il porte, par instants, un regard critique sur cette notion : « Mais dans le cas américain, cette purge est à double tranchant. Progressivement, la violence cinématographique se détache de la réalité, dans le sens où elle devient un spectacle, une esthétique une fin et non plus un moyen, perdant de sa dimension cathartique au profit de son pouvoir de fascination ». Et d’indiquer, sans hélas ! prolonger, la piste d’une fascination du tueur en série à relier avec l’individualisme hobbesien (« L’homme est un loup pour l’homme », etc.) et, au fond, avec l’anthropologie libérale, qui est celle des Américains.
Il répète aussi l’argument bien connu selon quoi l’art ne serait qu’un reflet de la société (singuliers miroirs, dans ce cas, que les fantaisies de Redon ou les étranges abstractions de Wols…). S’il est violent, c’est donc que la société l’est aussi et qu’il agit donc comme un miroir tendu. D’une certaine façon, l’abord de Julien Bétan apparaît comme pétri par le libéralisme socio-culturel ambiant dit « de gauche », lequel ne remet guère en question une conception de la liberté – qui s’applique aux arts aussi bien qu’aux questions sociétales – qui est au fond également celle du libéralisme économique, à savoir que la société n’est que la somme des égoïsmes.
Or, il serait pertinent de penser par-delà le bien et le mal, c’est-à-dire par-delà des considérations morales qui risquent de rejeter toute critique dans le camp où s’indifférencient la Réaction, le conservatisme et plus généralement « la-droite ». Le défi que pose le cinéma d’horreur dans ses développements extrêmes, si souvent lové contre le libéralisme économique tout comme les diatomées sur la baleine, est d’abord à éclairer sur le plan neurobiologique et sur le plan cognitif. Autrement dit : quels sont les effets cognitifs, chez le spectateur, du spectacle de la cruauté ? Quel sensation cherche le spectateur dans ce cinéma ? Que dit de notre société la recherche de sensations extrêmes passant par le spectacle simulé (ou réel, cf. les cas du journaliste Nick Berg dont la vidéo de décapitation fit un carton, ou bien le plus récent cas du dépeçage par Rocco Magnotta d’un étudiant chinois) de tortures ?
Cela appelle à penser la société, à penser la possibilité de faire société, penser donc les symboles, les causes communes et les limites communes que s’assigne une société. La question est alors moins morale, que cognitive et anthropologique : comment et que penser (d’)un cinéma prônant non pas le défi à une morale immonde – qui rendrait défendable sa nature transgressive –, mais supposant l’acceptation de tout par une société aspirant à l’a-moralité et à l’a-nomie au nom de ce que « chacun voit midi à sa porte » C’est pourquoi il est capital de penser historiquement (voire historicistement) et anthropologiquement le phénomène « extrême ». Ce que ne peuvent cerner des balivernes au fond tout à fait idéologiques, sur le mode binaire « liberté vs. censure », ni une interprétation commodément décontextualisée de la catharsis aristotélicienne, ni la préférence à valider les intentions d’un « artiste » plutôt qu’à analyser les effets produits sur le public et la société. Car, sur ce mode, la prétention d’un réalisateur à faire métaphore (le cas de l’abject Serbian Film) suffit à faire oublier qu’il n’y a dans le résultat produit aucune métaphore intrinsèque patente. Quand la chose n’est claire que pour l’énonciateur, cela devient l’autisme, la mort du symbole, donc de la possibilité de faire société.
En outre, un aspect supplémentaire intrigue dans le cinéma d’horreur extrême, et plus singulièrement dans un courant de films se voulant dénonciateurs : qu’il s’agisse du réactionnaire Saw, du plus « progressiste » Hostel 2, de Serbian Film ou du récent – et guère extrême – La Cabane dans les bois, la dénonciation n’est en fait qu’une énonciation, la démonstration qu’une monstration. Là encore, un point commun avec l’art contemporain, donc : il faut dans les deux cas ne donner crédit qu’à l’intention de dénoncer, donc fermer les yeux sur le fait qu’il n’y a qu’un énoncé. En fin de compte, le cinéma d’horreur extrême expose une violence abjecte avec le prétexte – ou l’intention bien réelle, ce qui est pire encore – de dénoncer la violence abjecte (Abu Ghraïb et la torture en Irak, le néolibéralisme et sa tendance à tout marchandiser, ou encore la guerre de Serbie). D’où l’on conclut à une incapacité totale à penser – et à contrer – la violence économique, politique, sociale et graphique, avec d’autres outils que les siens. Il ne reste au total qu’à observer l’état de désarmement intellectuel de créateurs capables de ne penser contre l’abjection sociale et économique qu’en la reproduisant, croyant combattre le feu par le feu lorsqu’ils ne font qu’alimenter sa force dévastatrice d’un surcroît de flammes.
Là encore, le parallèle avec l’art contemporain est évident. Il suffit de rappeler l’exemple de la « performance » 3000 huercos de Santiago Sierra : « En 2002 sur un terrain situé en face de la cote marocaine, Sierra fit creuser 3000 trous de la taille indiquée, alignés verticalement et horizontalement. Le travail fut effectué par un groupe de personnes de 20 à 7 selon les jours, pour la plupart immigrés sénégalais ou marocains, dirigés par un contremaître espagnol. Ils furent rémunérés comme le préconisait l’Etat espagnol, c’est-à-dire 54 euros pour huit heure de travail par jour. En privant les participants de toute aide mécanique, Sierra ramène le travail à ce qu’il a de plus élémentaire, de moins qualifiant, ôtant toute compétence secondaire aux ouvriers, et montrant ainsi une forme d’aliénation dans le travail » (source : http://www.technoromanticism.com/wiki/wakka.php?wiki=SantiagoSierra).
Il n’est pas sot de se poser des questions naïves : pourquoi le cinéma d’horreur ? Que dit-il vraiment de notre temps ? Quels sont les effets perceptifs et cognitifs produits ? Comme l’énonçait autrefois Victor Klemperer, analysant les causes de la montée du nazisme, faut-il craindre que « (…) l’exagération permanente appelle un renforcement croissant de l’exagération et l’émoussement de la sensibilité ; le scepticisme et, pour finir, l’incrédulité ne peuvent manquer d’en découler » ? Le passage du cinéma d’horreur extrême de la confidentialité aux succès de masse – et à la visibilité à tout âge, comme le porno, grâce à Internet – n’appelle-t-il pas à repenser totalement son statut ? Pourquoi la culture bénéficierait-elle d’une sorte de liberté irresponsable consistant à dire et montrer absolument tout et surtout le plus insoutenable ? Où va une société détruisant tout repère, tout tabou, toute limite, serait-ce de façon fictive ?
Cela rejoint les propos de la journaliste Jenny McCartney, que rapporte l’auteur : « En 2007, une journaliste du Telegraph, réagissait ainsi à la sortie d’Hostel (Eli Roth, 2006) : “Je ne sais pas ce que des individus peuvent trouver d’agréable à regarder des scènes de tortures prolongées, mais il est de plus en plus évident qu’ils sont nombreux. En tant que critique cinématographique, ma réaction est sans doute extrême, mais se situe à l’opposé du plaisir. Je ne peux trouver aucun amusement macabre dans de telles scènes – comme certains critiques l’affirment –, ni me détendre pour noter les références ironiques du réalisateur à d’autres films d’horreur. Au lieu de cela, j’ai la nausée et me sens profondément déprimée. La vue de personnes couvertes de sang implorant qu’on leur laisse la vie sauve, filmées en long et en large, ne ressemble pas à du divertissement, mais plutôt à une terrible réalité ” ».
Se pose, en dernier ressort, une problématique que seule pourrait éclairer une réflexion articulant l’anthropologie à la politique, à savoir le rôle et le statut de la violence dans une société civilisée – en apparence – pacifiée, qui a discrédité la violence, invisibilisé la mort (comment ne pas voir dans le cinéma d’horreur un retour du refoulé social, un possible glacial memento mori de sociétés ne promettant même plus d’au-delà à la chair et à la mort ?), les ayant rendues taboues. Autrement dit : quel exutoire donner à la violence humaine, ce phénomène anthropologique transversal à l’humanité ? La théorie du bouc-émissaire d’un René Girard offrirait un biais intéressant pour considérer le phénomène de l’extrême dans les sociétés modernes.
Cet essai de Julien Bétan peut donc faire office de première approche pour se questionner sur le phénomène de l’extrême, ici appliqué au cinéma d’horreur, que l’auteur connaît très, très bien. Mais il y manque, peut-être, une ambition intellectuelle plus haute, qui ne se contenterait pas d’oblitérer le discours selon quoi le cinéma d’horreur est un miroir de la société, une provocation nécessaire contre les hypocrisies dominantes, etc. Ainsi, lors Julien Bétan conclut : « En refusant de dépasser les limites, nous nous condamnons à ne jamais les voir reculer », l’on pourrait lui répondre : « nous nous condamnons surtout à n’avoir plus de repères, de normes, donc de moyens de penser le monde et se situer ». C’est, au fond, un discours postmoderniste, qu’il n’est que trop urgent de dépasser. S’il est aujourd’hui compris comme réactionnaire d’exiger des limites, des frontières, des repères, c’est parce que les amoureux de leur époque ont oublié que les grands révolutionnaires ont souvent été de grands réactionnaires.
Au fond, ce livre indique surtout, par contraste, une béance, un manque : une anthropologie de l’extrême reste encore à faire, qui engloberait le champ des musiques extrêmes, la pornographie, le gore jusqu’au-boutiste dit « gornography », ou encore l’art contemporain dans ses versants les plus extrémistes.
Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes, Julien Bétan, Les Moutons électriques éditeurs, 2012, 19€.




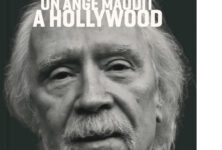









One thought on “« Extrême : Quand le cinéma dépasse les bornes », un essai sur le cinéma d’horreur en demi-teinte”
Commentaire(s)