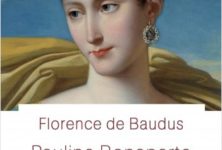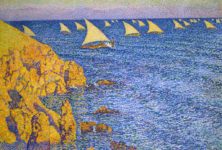“Les soeurs de Napoléon, trois destins italiens” au musée Marmottan
En 2014, à l’occasion du bicentenaire de son décès, Joséphine de Beauharnais sera au centre de plusieurs manifestations. En attendant, l’exposition du musée Marmottan consacrée aux sœurs de Napoléon salue le destin de trois jeunes femmes en prise avec leur temps.
[rating=4]
Votre petite fille rêve de robes de princesses et de prince charmant ? Voici une bonne occasion de rétablir quelques vérités. Si le parcours de l’exposition recèle son lot de colifichets, dont un manteau de pourpre, un peigne de corail (réalisé par la manufacture de Naples), un sac à main en cuir ayant appartenu à Pauline, des bijoux et des camées, l’ambition de la commissaire est tout autre : il s’agit ici de montrer comment les trois sœurs de Napoléon Bonaparte l’ont aidé à accomplir son dessein européen.
Ainsi, Elise fut-elle l’artisane, avec son frère Lucien, du rapprochement avec l’Eglise de Rome au moment du Concordat ; Pauline, d’une imparable beauté, fut confiée par son frère en secondes noces au prince romain Camille Borghèse, scellant un rapprochement entre la cour française et cette grande famille italienne profondément républicainre et franchophile ; quant à Caroline, en montant sur le trône de Naples au côté de son époux Murat, elle marqua de son empreinte la vie culturelle du sud de la péninsule.
Pour accueillir cette exposition, le musée Marmottan a subi d’importants remaniements, prélude à un rapprochement annoncé avec la bibliothèque Marmottan. Pour l’heure, les toiles de Monet sont redescendues à l’étage inférieur et l’ensemble des pièces à vivre du rez-de-chaussée vont vivre pendant quelques mois au rythme de l’Empire. Du point de vue artistique, il est notamment intéressant de confronter le rayonnement du grand portrait à la française avec les toiles italiennes de format plus modeste, ou encore de saisir ce qui distingue un portrait romantique champêtre des princesses, simplement vêtues de tuniques blanches et de châles en cachemire, de ces monumentaux “portraits de robe” lorsque leurs fonctions exigent qu’elles accomplissent un rôle de représentation.
Le caractère éminement européen de leur destin est également mis en évidence, à travers l’évocation des résidences qu’elles ont occupées et transformées à leur goût, les membres de la société intellectuelle qu’elles parvenaient à attirer dans leurs salons, leurs commandes aux différentes manufactures françaises et italiennes, leurs nombreux voyages.
Enfin, la dernière salle permet de découvrir une toile d’Ingres, longtemps non attribuée puis redécouverte lors d’une restauration en Belgique : ce délicat portrait de Caroline lors de la dernière année de règne de Murat montre bien à la fois la gravité de la jeune femme qui tient son rang, ainsi que le cadre enchanteur de sa villa de Portici, dont la terrasse plantée de citronniers donnait sur la baie de Naples.
Finalement, il se pourrait que les petites filles quittent le musée en gardant leurs rêves intacts…
Visuels :
Jean-Louis-Victor Viger du Vigneau, dit Hector Viger, La toilette avant le
sacre, vers 1865 © Marseille, musée des Beaux-Arts/Raphaël Chipault-Antonin Soligny
Anonyme, Portrait présumé de Caroline Murat © RMNGP
Manufacture de Sèvres, Jean-François Robert et Jean-Baptiste Gabriel Langlacé,
Déjeuner des vues des environs de Sèvres, 1813 © Patrice Maurin-Berthier
Peigne ayant appartenu à Caroline Murat © Roma Capitale – Sovrintendenza ai Beni Culturali
Sac à main de Pauline Bonaparte © Thierry Jacob