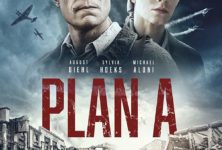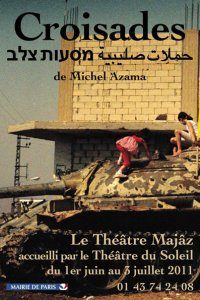
Majâz présente Croisades au Théâtre du soleil
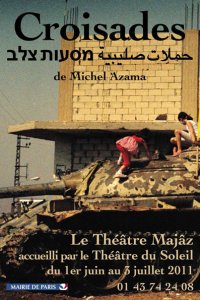 Ariane Mnouchkine et le Théâtre du soleil invitent les acteurs du théâtre Majâz à se produire pour trente représentations dans une salle de répétition de la Cartoucherie. Leur spectacle « Croisades » a parcouru déjà de nombreux lieux depuis sa création en 2009 et a été donné dans plusieurs villes en Israël. La jeune équipe artistique est formée d’acteurs d’horizons différents, des palestiniens, israéliens, franco-libanais, franco-algériens, franco-israéliens. Ils jouent d’ailleurs dans trois langues dont le français. Ils se sont rencontrés à l’Ecole internationale de Jacques Lecoq et partagent la conviction de faire du plateau de théâtre un espace de dialogue, de partage, d’interrogations politiques et humaines.
Ariane Mnouchkine et le Théâtre du soleil invitent les acteurs du théâtre Majâz à se produire pour trente représentations dans une salle de répétition de la Cartoucherie. Leur spectacle « Croisades » a parcouru déjà de nombreux lieux depuis sa création en 2009 et a été donné dans plusieurs villes en Israël. La jeune équipe artistique est formée d’acteurs d’horizons différents, des palestiniens, israéliens, franco-libanais, franco-algériens, franco-israéliens. Ils jouent d’ailleurs dans trois langues dont le français. Ils se sont rencontrés à l’Ecole internationale de Jacques Lecoq et partagent la conviction de faire du plateau de théâtre un espace de dialogue, de partage, d’interrogations politiques et humaines.
La pièce de Michel Azama date de la fin des années 80, elle décrit un territoire et une population séparés en temps de guerre. Elle veut tendre à l’universalité tout en faisant comprendre qu’il s’agit bien du conflit israélo-palestinien. Embarqués dans la guerre, des femmes et des hommes y sont à la fois les victimes et les bourreaux, ont-ils le choix ? Ils sont dans l’impossibilité de fraterniser, d’aimer, ne trouvent pas de place pour les sentiments immédiatement contrariés par la violence et la haine. Ils tuent ou sont tués, parfois sans motivation ni but, comme un réflexe défensif ou comme une attaque provocante de l’ennemi. Cette mise à mal de l’altérité est le sujet principal de Croisades.
Les acteurs sont investis, jouent chacun plusieurs rôles avec un vrai sens du collectif et de l’écoute, ils se donnent pleinement et livrent une interprétation vivante, vibrante, souvent crédible des tiraillements, des sentiments éprouvés aussi forts que l’amour et la haine, la douleur, l’espoir, mais ils sont aussi un peu bruts et ne parviennent pas toujours à toucher. Tous les personnages présentés vivent un destin éminemment tragique et la mise en scène de Ido Shaked beaucoup trop « théâtrale » n’en restitue pas l’épaisseur, la puissance. Le texte aussi pose problème tant il est bavard jusqu’à la complaisance. Moins de mots et plus de suggestions et de silences auraient rendu la représentation plus saisissante. Et que penser de cette méfiance systématique de la fable à l’égard de tout réalisme, des morts qui se relèvent pour s’adresser aux vivants, du mélange des époques et des costumes. Cette trop grande mise à distance entre en contradiction avec la volonté de représenter parfois assez crument les atrocités d’une dure et bouleversante réalité.