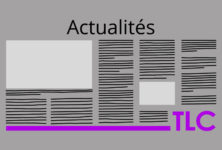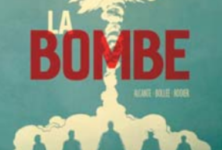« Le jeu des 1000 euros » au 104
Inutile de présenter le jeu des 1000 euros aux personnes élevées au son de France Inter. Quant aux autres, la pièce de Bertrand Bossard leur offre la possibilité de découvrir le jeu le plus ancien du paysage radiophonique français. Encore mieux qu’une découverte, le metteur en scène-comédien ressuscite l’émission la plus populaire en direct.
Né en 1958, dans un chapiteau dressé sur la place du marché de la Ville de Blanc dans l’Indre, le jeu phare de France Inter a su traverser le temps, changeant successivement de nom. Nommée « Cent mille francs par jour » à sa création, « Jeu des mille nouveaux francs » en 1960 puis le « Jeu des 1 000 francs » jusqu’en 2001 avant l’avènement de l’euro, l’émission s’appelle désormais « le jeu des 1000 euros ».
Mais Bertrand Bossard ne situe pas l’action aujourd’hui. Il faut se projeter dans deux siècles, quand nos cerveaux seront tous lobotomisés. Le jeu, populaire certes, mais faisant appel à la culture générale (les candidats doivent répondre à des questions envoyées par les auditeurs) a été éradiqué pour être remplacé par des émissions télévisées parvenant difficilement à stimuler nos neurones. Pour éveiller nos consciences, le duo d’animateurs époustouflants (habillés en cosmonautes du futur) cherchent à éveiller la conscience du peuple en faisant renaitre l’émission. Tout y est, le code couleur en fonction de la difficulté de la question posée, la question Banco, le super Banco, les soupirs, le silence, le suspense jusqu’au glockenspiel (vous ne connaissez-pas?), le petit métallophone à quatre lames, emblème sonore du jeu.
L’émission débute alors, de manière traditionnelle, comme si elle était enregistrée en direct devant nous. Le public est appelé à jouer. Mais seuls les comédiens dissimulés dans le public, mêlés aux preux participants, parviendront à déjouer les éliminatoires et se prêter au jeu réellement.
Mais l’enregistrement va vite dérailler, les candidats sous pression se rebellent contre telle ou telle question, mettant en cause son origine. Ainsi, on y apprend que Goethe n’est pas le père du romantisme allemand mais du mouvement « Strurm und drang ». On regrette les cris un peu forcés de la comédienne qui souffre terriblement lorsqu’elle apprend que le romantisme est un courant littéraire et non simplement l’état de tendresse dégoulinant d’attentions.
Bertrand Bossard s’éloigne du jeu au fur et à mesure de l’enregistrement, que ce soit lorsqu’un candidat sort de ses gonds ou lorsque l’assistant-xylophone se rebelle et incarne le « Révolté » de Camus ou encore pour un petit aparté musical (la question de repêchage peut être fondée sur document sonore). Cette dernière initiative est louable car les musiciens de cet intermède musical, différents selon les représentations, donnent un petit concert à la fin de la pièce.
Ces parenthèses explosives durant le jeu nous invitent à nous interroger sur le savoir universel, sur l’endormissement des masses, la place de la connaissance dans nos sociétés. L’objectif n’est donc pas de « pallier toutes les lacunes et de sortir du Jeu avec un savoir encyclopédique » souligne la dramaturge Marion Richez mais plutôt de « pointer du doigt la supercherie humaine ». Les outils pour y parvenir sont parfois un peu décevants, à l’exception de l’incarnation du génie de Gilles Deleuze par les comédiens. Chaque comédien, habillé d’un lobe du cerveau du philosophe, tente de nous transmettre un bout de sa pensée…
Un spectacle ludique, futé et amusant qui, s’il n’a pas réussi à nous faire comprendre totalement les théories de Deleuze, nous aura permis de savoir que la Veules est le plus petit fleuve de France et qu’un sinophile est un passionné de la Chine.
(c) Christophe Raynaud de Lage