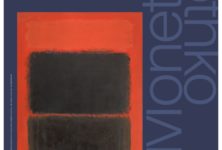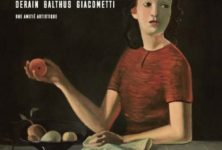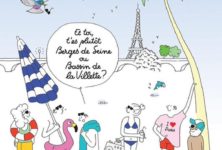“Serge Poliakoff, le rêve des formes” au musée d’Art moderne de la ville de Paris
Le peintre abstrait Poliakoff, illustre représentant de la seconde École de Paris née après la Seconde Guerre mondiale, n’avait jamais fait l’objet d’une grande rétrospective depuis 1970, suite à son décès. Une exposition qui s’inscrit dans une relecture plus tactile et sensorielle de l’histoire de l’abstraction.
Né en 1900 à Moscou, Serge Poliakoff a connu une enfance haute en couleur. Fils d’un éleveur de chevaux qui fournit l’armée du tsar, et d’une mère dévote qui lui fait découvrir les icônes, Poliakoff appartient à une immense fratrie de quatorze enfants, et compte de proches parents tziganes, qui lui apprendront à jouer de la guitare. Une culture slave qui lui permettra de se lier rapidement avec la communauté d’artistes russes vivant à Paris lorsqu’il y arrive à son tour en 1923. Aux côtés de Kandinsky et des Delaunay, il découvre peu à peu sa vocation artistique.
Pour autant, nulle nostalgie dans l’œuvre de Poliakoff. Si devant l’intense vibration de ses toiles abstraites, des critiques ont tôt souligné le rapprochement avec les icônes de son pays natal, lui ne parle que d’humanité et de vie, reprenant souvent l’image de l’œuf, forme géométrique simple qui ne prend tout son sens que s’il est réellement porteur d’une vie à naître.
Difficile alors d’imaginer un parcours d’exposition autour d’un peintre qui, inlassablement, remet sur le chevalet le même tableau. Dominique Gagneux le dit elle-même, elle s’est modestement contentée de repérer de grands axes souples parmi ces séries de toiles, qu’elle a sobrement intitulés, comme “transparences”, “lumière de la couleur” ou “le rêve des formes en soi”.
Ponctué de quelques vitrines d’archives et d’un film, le parcours s’efforce de dévoiler le cheminement lent et laborieux d’un peintre passionné par la couleur, la matière, la lumière et les pigments qu’il broie lui-même. Une quête qui n’exclut pourtant pas les autres grandes expressions culturelles de l’humanité : l’architecture comme structure, et la musique comme interprétation de la vibration lumineuse.
Comme la commissaire le note dans un texte intitulé “Synesthésies” dans le catalogue de l’exposition, Poliakoff part du chaos, du tumulte du monde, et commence par ancrer sa toile autour de deux formes géométriques. Puis, en superposant les couches picturales, il ébauche un agencement de couleurs délicat qui se joue des transparences et des effets de matière, jusqu’à ce qu’il parvienne à retrouver le silence.
Pour autant, son oeuvre ne s’élabore pas complètement hors du monde ; Yves Saint-Laurent réalisera des robes à partir de gouaches de Poliakoff, et la dernière salle montre une ouverture aux courants contemporains qui l’entourent. Un parcours contemplatif qui réconciliera les plus réfractaires à la puissance sensible de l’abstraction.
Visuels (toutes œuvres de Serge Poliakoff) :
Composition en rose, 1954, © Photographe : Sandra Pointet, © ADAGP, Paris 2013
Composition abstraite, ca. 1968, © Photo Daniel Mille, Monaco © ADAGP, Paris 2013
Composition, 1950 © Museum Wu?rth, Ku?nzelsau/ Photo Philipp Schnborn, Munich © ADAGP, Paris 2013
Espace orangé, 1948, © Liège, Musée des Beaux-Arts (BAL) © ADAGP, Paris 2013
Composition murale, 1965-1967 © Centre Pompidou, MNAM-CCI © ADAGP, Paris 2013