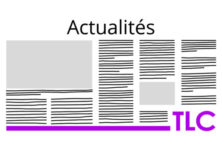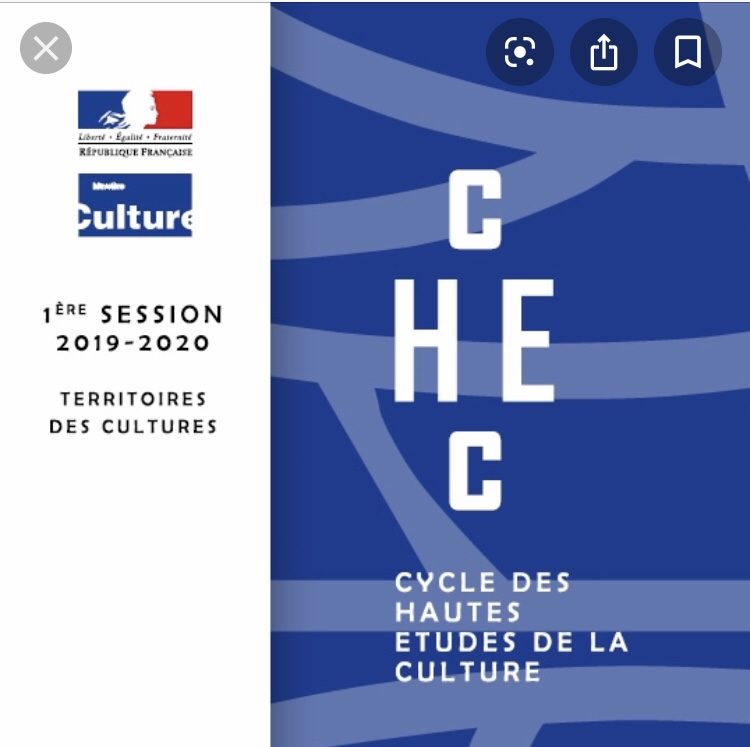
Lancement du Cycle des Hautes Études de la Culture (CHEC)
Ce 12 septembre, lors d’une journée ouverte par le ministre Franck Riester, rue de Valois, la première session annuelle du Cycle des Hautes Études de la Culture a été inaugurée en présence des partenaires et de la première promotion d’auditeurs qui suivent ce programme pendant 9 mois.
Manuel Bamberger, responsable du cycle qu’il a organisé avec son adjointe, Cécile Portier, a présenté rapidement le sujet et présenté les intervenants de la matinée. Programme novateur, le CHEC vise un triple horizon de décloisonnement, de partage, et de renouvellement des approches. L’objectif est de faire travailler ensemble sur plusieurs sessions concentrées les auditeurs, pour un renouvellement des visions sur les stratégies de politiques culturelles. Durant 10 mois, chaque année, les auditeurs et auditrices devront également effectuer des travaux de groupes sur des sujets déclinés de la thématique globale des « Territoires de cultures ». Les sujets proposés portent sur les 6 thématiques : « Education artistique et culturelle, territoires et numérique », « L’accompagnement des communs culturels par les acteurs culturels publics », « L’amélioration des passerelles entre le champ culturel et artistique, et les sciences », « Les mutations du patrimoine bâti », « Les droits culturels au service du lien citoyen et territorial » et « Entreprises et lien culturel »
Et les auditeurs ont commencé leurs travaux dans les salons du ministère par un premier dialogue entre le Président du comité d’orientation du CHEC, le philosophe Jean-Gabriel Ganascia et le Haut-Fonctionnaire et écrivain Bruno Racine. Revenant sur son expérience d’organisateur de la communauté des neurosciences en France, Monsieur Ganascia a parlé de sa prise de conscience de la manière dont les technologies modifiaient notre accès à la culture. Plus qu’avant nous avons tous la possibilité de créer et diffuser des œuvres et nous avons accès à une quantité astronomique de contenus. Le nombre d’ebooks en autoédition ou d’articles parus dans les péri-revues se multiplient. Face à cette grande masse, comment s’orienter et filtrer? Il y a des commissaires très humains, mais sur le web, il y a les algorithmes. Mais alors, quelles recommandations algorithmiques faire et qui décide de ces recommandations pour nous aider à nous orienter dans ce flux de contenus ? Monsieur Racine a évoqué sa trajectoire à la ville de Paris et son travail à la Villa Médicis, au Centre Pompidou et à la BNF avant de parler du caractère stimulant d’une formation transversale. Il a ensuite lancé des pistes importantes sur le lien entre culture et service public. Rebondissant chacun sur les propos de l’autre, Bruno Racine et Jean-Gabriel Ganascia sont arrivés à la question de savoir quel est le patrimoine de demain, à l’heure où dématérialisation la dématérialisation interroge la propriété et même la souveraineté. En final de leur discussion, les deux interlocuteurs ont passé en revue les médias influents d’aujourd’hui en évoquant notamment les séries et les jeux-vidéos avant de répondre aux questions et remarques des auditeurs.
Après les grandes questions posées par ce dialogue inaugural et une courte pause, le secrétaire général du ministère de la Culture, Hervé Barbaret, a proposé une visite brillante et pragmatique des coulisses de son institution en quatre points : l’organisation du ministère, ses enjeux, la place de la culture en France et le rôle du CHEC. Le ministère de la Culture représente un réseau puissant d’opérateurs, 1700 personnes travaillent organisation centrale, mais en tout ce sont 30 000 opérateurs, dont la plupart sont au plus près des citoyens. Monsieur Barbaret a ensuite évoqué la richesse de l’exception culturelle française, avant de résumer le fonctionnement du ministère. Puis il est revenu aux sources de ce ministère qui célèbre cette année ses soixante ans pour rappeler son ordre de mission originel du décret rédigé par Malraux en 1959 : “Assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres l’art et de l’esprit qui l’enrichissent“. Et s’il a dressé un bilan positif sur les 60 dernières années, l’un des enjeux majeurs restant est la capacité à attirer la plus vaste audience avec l’éducation artistique et culturelle. Pour lutter contre la défiance et encourager la bienveillance, pour Hervé Barbaret, il faut que les gens qui travaillent pour le ministère de la Culture évoluent, bougent, changent de poste et aient diverses perspectives. Veiller à une transversalité et à une mobilité large est l’un des grands enjeux que le ministère est amené à construire.
Les journalistes ont quitté la salle où les auditeurs du CHEC sont restés pour entendre, après le déjeuner, l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Ils passent les deux prochains jours à Bourges pour commencer en groupes, leur travail sur les «Territoires de culture ».
visuels : affiche et YH