
“Les Survivantes”, de Blandine Métayer et Isabelle Linnartz : une pièce anti-STRASS ?
Le Théâtre 13 accueille actuellement Les Survivantes, un spectacle de Blandine Métayer et Isabelle Linnartz écrit à partir de témoignages de prostituées recueillis par le Mouvement du Nid.
Le combat de cinq prostituées
Des tags à cour et à jardin, un abri en tôle ondulée, un baril où se réchauffer, des parpaings, une table et des chaises : la scénographie des Survivantes nous embarque tout de suite dans l’extrême pauvreté. Quant à la lumière rouge, diffusée en douche sur les chaises ou sortant du baril, elle nous signale d’emblée que nous entrons dans l’univers de la prostitution. Un signe peut-être un peu lisible, une scénographie un peu trop univoque. Qu’importe, cela fonctionne : nous nous laissons happer par les récits et les combats de ces cinq prostituées.
Car c’est bien d’un combat qu’il est question ici : celui de Rose, vingt-cinq ans de métier, qui emmène les autres à Paris pour militer pour l’abolition et la pénalisation des clients. Un rapide saut dans le temps qui nous permet, à nous, spectateurs, de connaitre l’issue favorable de ce combat. Une victoire pour Rose, présentée comme une victoire pour l’ensemble des prostituées. Et, justement, c’est dans cette écriture triomphante et cette trame on ne peut plus linéaire que se situe le problème principal de la pièce.
Une écriture univoque
Celle-ci pèche en effet dans son écriture par un défaut méthodologique, le seul recours aux témoignages du Nid. Cette méthode est présentée aux spectateurs comme un garant de vérité : le personnage de Rose (incarné par Blandine Métayer) est largement inspiré d’une prostituée réelle, Rosen Hicher, et l’ensemble des paroles des personnages sont des propos recueillis par le Nid. Il n’est donc pas question, ici, de contester leur véracité, ni leur représentativité des trajectoires de vie misérables de l’essentiel des prostituées. Cela ne change rien au fait que, pour proposer un théâtre de type documentaire, il eût été bon de confronter les points de vue, en se tournant notamment vers le principal organe représentatif des prostituées, le STRASS. Or, celui-ci ne lutte pas pour l’abolition mais pour une amélioration des conditions de travail des prostitué.e.s, en raison à la fois de la crainte de voir la clandestinité les précariser davantage et de la revendication du libre droit de disposer de son corps. Peut-être serait-il bon de rappeler ici que le Mouvement du Nid s’est construit dans le cadre du catholicisme social et que ses prises de position sur la question de la prostitution sont empreintes d’idéologie religieuse, qui transparaît d’ailleurs dans la pièce par le lexique, notamment l’omniprésence de la question de l'”âme”.
Or, si la pièce, grâce à différents personnages, accorde par moments une place à ces voix discordantes, c’est pour, simultanément, les discréditer, les personnages qui les portent faisant l’objet de dénigrements systématiques : Birgit, masseuse “thaïlandaise”, est ridicule de ne pas admettre que son métier est celui de la prostitution ; les hommes – en l’occurrence, les proxénètes et les clients – sont monstrueux d’utiliser l’argument de la précarisation pour manifester leur désaccord. Par cette représentation, les objections sont balayées d’emblée sans que le débat ne soit véritablement représenté. Surtout, cette pièce ressemble dès lors à une commande du Nid contre le STRASS. Elle est coproduite par l’association catholique, dont la revue lui accorde même une pleine page, et les principaux thèmes tournés en ridicule sont bien ceux que porte le STRASS : une approche complexe du travail du sexe et ainsi le refus d’employer indistinctement le terme de “prostituée” pour tout ce qui en relève (massage, strip-tease, pornographie…) ; le choix du mot “pute”, rejeté par la pièce mais revendiqué par les militant.e.s du STRASS, par opposition, précisément, à un “prostitué.e” construit sur un participe passé et, partant, supposant la passivité de la personne ainsi désignée ; enfin, on l’a compris, le risque de précarisation accrue avec la clandestinité induite par la pénalisation des clients. Bien entendu, les autrices n’auraient pas davantage dû se fier aux seuls propos du STRASS – l’écueil eût été le même, celui d’un discours monolithique – mais elles auraient dû faire véritablement état de ces divergences, tant il est difficile, en matière de prostitution, d’avoir des analyses certaines et complètes sur la situation.
Il reste que la scénographie, bien qu’excessivement monosémique, fonctionne bien et permet même de jolis tableaux. Quant au texte, il offre de belles respirations grâce à des détours par l’humour. Saluons également les prestations de Jean-Claude Leguay, tout à tour, père, client et proxénète, de Blandine Métayer et Catherine Wilkening.
Visuel : Lionel Roy
Infos pratiques
Articles liés
2 thoughts on ““Les Survivantes”, de Blandine Métayer et Isabelle Linnartz : une pièce anti-STRASS ?”
Commentaire(s)
Publier un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée.
Publier un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée.





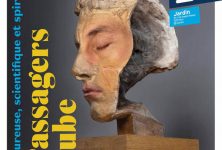








FOURNIER
Bonjour,
Je ne suis pas d’accord. Si la pièce avait proposé les deux combats divergents (celui du Mouvement du Nid et celui du STRASS) on l’aurait qualifiée de “tiède”, on aurait dit qu’elle ne prend pas parti, qu’elle ne va pas au bout du sujet, qu’il n’y a pas de point de vue. Quoique l’on fasse, on a perdu d’avance parce que c’est un sujet très clivant. Je trouve dommage que votre article soit articulé autour du coté “anti STRASS” de la pièce, alors que l’important est avant tout qu’on parle du sujet.
Lhuillier
Cette pièce n’est pas anti STRASS mais abolitionniste.