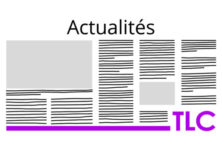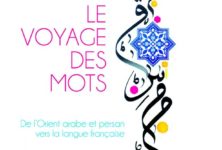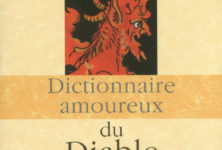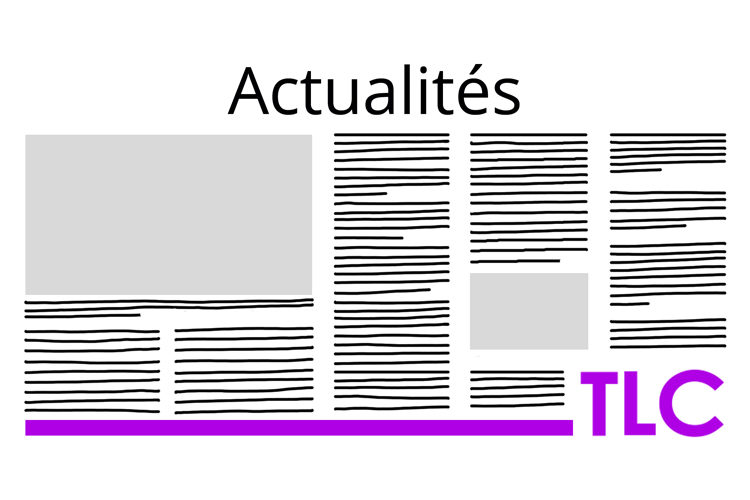
Mort d’Alain Rey, le lexicographe joyeux
Chacun se souvient de sa longue chevelure blanche un peu folle, qui évoque la fameuse image d’Einstein tirant la langue : l’œil toujours malicieux, le linguiste et lexicographe Alain Rey était à l’affût des nouveautés du – ou des – français. Une façon de lutter contre la sclérose des puristes et autres “sorbonnicoles” honnis par Rabelais.
Alain Rey ou l’érudition joyeuse
Traqueur infatigable des mots et de leurs voyages dans nos imaginaires, Alain Rey était en effet un Rabelais moderne : sa grande érudition lui permettait d’aborder le savoir avec fantaisie.
Connu du grand public pour les chroniques qu’il tint sur France Inter de 1993 à 2006 (et qu’il continuera ensuite au Magazine littéraire), le linguiste savait, à partir d’un simple mot, nous proposer un véritable panorama de la société contemporaine. C’est cette vie qu’il donnait au langage qui nous manquera sans doute le plus : loin de se réduire à de simples sons ou lettres mis bout à bout, les mots, avec Alain Rey, révélaient sans en avoir l’air des pans entiers d’histoire et de sociologie contemporaine. C’est ainsi que l’on se balade et se perd avec délices dans son immense Dictionnaire culturel en langue française.
Un militant d’un français sans frontières
Ce rapport mouvant au savoir et à la langue fit d’Alain Rey un véritable militant d’une langue française poreuse aux emprunts linguistiques et aux néologismes. Ainsi fit-il entrer le verlan et l’argot dans son Robert et rappela-t-il dans de multiples ouvrages que le français que défendent à cors et à cris les “puristes et autres censeurs” est lui-même le fruit de multiples emprunts à d’autres langues (allemand, italien, anglais, arabe…), à des français régionaux ou à différents sociolectes. Un petit tour dans les pages de L’amour du français : contre les puristes et autres censeurs de la langue (Denoël, 2007) ou Le voyage des mots : de l’Orient arabe et persan vers la langue française (Guy Trédaniel, 2013) suffisent à s’en convaincre.
Enfin, ce chef d’œuvre d’archéologie linguistique qu’est son Dictionnaire historique du français assure à lui-seul la postérité du linguiste : quel meilleur moyen de tuer les trop longues soirées de couvre-feu que de dévorer avec appétit ses quelque trois mille pages ?
Visuel : Laetitia Larralde