
Cannes 2023, Compétition : Jeunesse qui bouillonne
Difficile de juger un film présenté en Compétition pour la Palme, qui n’est en fait qu’une part d’un ensemble plus grand. Cette première partie de Jeunesse est en tout cas porteuse de parti-pris assez passionnants.
Le documentariste chinois Wang Bing est un magicien – lucide – dans l’art de filmer la parole. Ses films Fengming – Chronique d’une femme chinoise, qui dure un peu plus de trois heures, ou Les Âmes mortes – qui dure 8h30 – sont magnifiques. Longuement, il s’attache à ceux qui lui racontent leurs vies dans les temps troublés de l’histoire de la Chine durant lesquels Mao Zedong gouvernait. Il entoure leur être et leurs mots d’un voile précieux qui se fait révélateur : par la durée et le montage – ainsi qu’une forme de constance, aussi – il fait jaillir d’eux et de leurs paroles une lumière particulière, à rencontrer à tout prix dans une vie de spectateur.
Cette première partie de Jeunesse présente bien entendu, elle aussi, une forme documentaire donc. Sous-titrée “Le Printemps”, elle dure un peu plus de trois heures trente. Mais elle est une part d’un film plus long. Cette première caractéristique peut la rendre pas évidente à juger : on aimerait en effet pouvoir se trouver d’emblée face à l’ensemble complet, afin de prendre le pouls du sujet traité en profondeur et de mesurer la valeur des partis-pris, de façon profonde également.
Vivre une jeunesse, tout de même
Ces partis-pris, on a cependant le loisir ici de les suivre et de les éprouver. Cette première partie de Jeunesse relève de la part de l’œuvre de Wang Bing au sein de laquelle la caméra bouge beaucoup. On retrouve cependant ce qu’on aime chez le documentariste chinois : le cadre n’est pas esthétisé, tout semble filmé sous une lumière assez crue et réaliste.
Le but de son travail, ici, reste de donner à voir les existences de jeunes n’étudiant pas et travaillant dans des ateliers de couture où les conditions sont assez rudes et rudimentaires, et les payes misérables, le tout au sein de la Chine actuelle. Habitant au sein même de ces lieux – vétustes, sombres, assez sales – ils composent une petite communauté, qui peut s’unir à l’heure de la contestation des payes maigres, mais apparaissent tous tout de même très fixés sur leurs buts personnels et leurs existences.
Ce qui les unit semble être une envie de vivre cette jeunesse qu’ils ont malgré tout, et ce malgré leurs conditions de vie peu évidentes. A l’écran, ils apparaissent joviaux, bouillonnants d’une envie démente de s’exprimer. N’évoquant pas leurs difficultés, ils rigolent, mettent leur musique très fort, vivent leur présent.
La vie, à vivre ou à observer
L’effet produit reste particulier : malgré sa sobriété, ce morceau de documentaire apparaît traversé par un souffle de vie qui emporte tout de suite. Les protagonistes peuvent tout de suite apparaître proches, le cadre, familier d’une certaine manière.
Il n’empêche que Wang Bing prend également le parti de ne pas livrer littéralement d’informations concrètes sur les enjeux sociaux du contexte qu’il décrit. Non pas qu’ils coulent de source : on a davantage l’impression, au terme de cette première partie de Jeunesse, qu’ils doivent nous apparaître via le temps que nous passons à fréquenter les personnes à l’image, à les approcher, à les comprendre, à les apprécier ou non.
Lâché dans cet espace décrit, tout en contradictions et en survie forcée, on peut en devenir aussi l’un des éléments constitutifs. Idéal pour comprendre tout le reste. D’ailleurs, le fait qu’on le regarde, cet espace, ne nous fait-il pas devenir l’un de ses éléments constitutifs ? Wang Bing nous suggère cette idée, à sa manière, pas pressé d’impressionner.
Le Festival de Cannes 2023 se poursuit jusqu’au 27 mai.
Retrouvez tous les films du Festival dans notre dossier Cannes 2023
*
Visuel : © 2023 House on Fire, Gladys Glover et CS Production







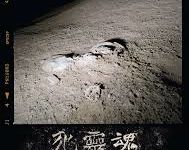

![[Critique] « Les Trois Soeurs du Yunnan », documentaire qui manque d’enjeu dramatique](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/306539/Les-Trois-Soeurs-du-Yunnan-222x150-c.jpg)




