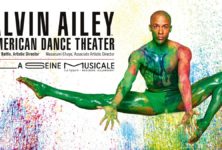Les étés de la danse rendent hommage à Paul Taylor
Le temps de dix représentations, Les étés de la danse nous invitent à découvrir 13 ballets de la Paul Taylor Dance Company. Nous avons assisté hier à la présentation de quatre d’entre eux. L’occasion de rendre un bel hommage à un chorégraphe octogénaire, dont la verve ne tarit pas.
Aureole (Händel) – 1962
Cette pièce maîtresse de Taylor, qui fêtera son cinquantenaire en août, peut se lire aujourd’hui comme une déclaration d’intention : jeune chorégraphe un temps attiré par les recherches avant-gardistes de Cunningham, Taylor choisit une autre voie, plus proche de ses émotions. Ainsi, Auréole a pu être qualifié de « ballet blanc » de la danse contemporaine : sur des extraits de Haendel, cinq danseurs jouent avec les codes du classique. La couronne des bras devient un cercle mobile, les entrées et sorties de scène introduisent des ruptures ou des diversions, les lignes que parcourent les danseurs n’en finissent pas de sinuer. Les pas glissés et les changements de pied continuels nous ramènent vers l’enfance. La pureté le dispute à l’agilité, dans cette écriture chorégraphique plus complexe qu’elle n’en a l’air.
Big Bertha – 1970
 Derrière son décor cliquant, Big Bertha est sans doute la pièce la plus sombre de la soirée. S’emparant des codes de la fête foraine, Paul Taylor revisite avec un humour grinçant ce qui ressemble à la promenade d’une famille américaine moyenne à Coney Island. Rapidement pourtant, l’entrain survolté de la gamine aux couettes suscite l’effroi, tandis que la mère un peu raide regarde le père partir à la dérive, perturbé par le dérèglement d’un automate grivois, juché sur une paire de bottes en latex rouge qui feraient pâlir d’envie tout drag queen qui se respecte. Une pochade aussi inquiétante que burlesque, qui laisse entrevoir la face sombre de Taylor.
Derrière son décor cliquant, Big Bertha est sans doute la pièce la plus sombre de la soirée. S’emparant des codes de la fête foraine, Paul Taylor revisite avec un humour grinçant ce qui ressemble à la promenade d’une famille américaine moyenne à Coney Island. Rapidement pourtant, l’entrain survolté de la gamine aux couettes suscite l’effroi, tandis que la mère un peu raide regarde le père partir à la dérive, perturbé par le dérèglement d’un automate grivois, juché sur une paire de bottes en latex rouge qui feraient pâlir d’envie tout drag queen qui se respecte. Une pochade aussi inquiétante que burlesque, qui laisse entrevoir la face sombre de Taylor.
Roses (Wagner/Baermann) – 1985
Après l’entracte, le spectacle reprend avec une pièce plus abstraite, dans la veine d’Aureole. Six couples évoluent sur scène, cinq vêtus de noir et un vêtu de blanc. Les longues jupes qui magnifient la féminité des danseuses rappellent les années de formation de Paul Taylor chez Martha Graham, une influence non négligeable sur son style chorégraphique. Si l’on retrouve les traversées latérales d’Aureole, le chorégraphe s’intéresse ici surtout à l’union, au couple dansé. Sur des opus de Wagner et Baermann, les couples revisitent le pas de deux avec lyrisme et tendresse à la fois. Michael Trusnavec, danseur en blanc, se distingue par l’intensité de sa présence.
Company B (Andrews Sisters) – 1991
Et pour finir, une pièce plus récente, présentée pour la première fois à Paris. Accrochée aux rythmes endiablés des Andrews Sisters, Company B. nous entraîne avec bonheur vers une nostalgie bon teint. C’est toute une iconographie américaine liée aux GI’s américains qui est convoquée ici, assombrie en arrière-plan par les silhouettes de combattants qui se détachent en contrejour. Dansons, rions tant qu’il est temps, pour oublier les conflits et conjurer le sort.
La danse, chez Paul Taylor, résonne comme une célébration de la vie, une invitation à la légèreté face aux contingences souvent sombres des destinées humaines. Hommage parisien à un chorégraphe moins lisse qu’il ne paraît.
« Les métaphores – les images produites par le mouvement – sont l’essentiel de mes ballets et mon credo est de tenter d’illustrer par la danse, de traduire au mieux par le corps, la condition humaine. Je suis un pessimiste plein d’espoir, et j’observe les choses sous ce double éclairage d’ombre et de lumière. »
Paul Taylor dans Private Domain, 1987.
visuels : Company B (James Samson) © Photo : Paul B. Goode
Paul Taylor © Paul Palmaro
Big Bertha (Amy Young, Michael Trusnovec et Eran Bugge) © Paul B. Goode