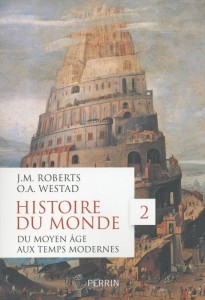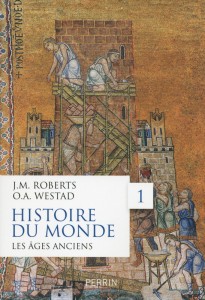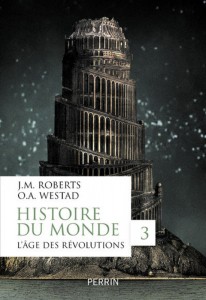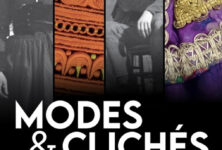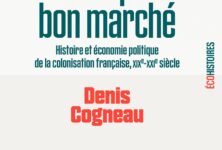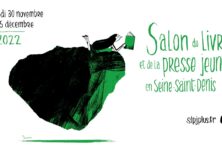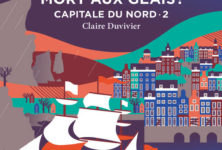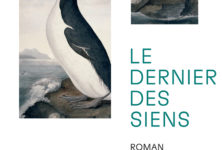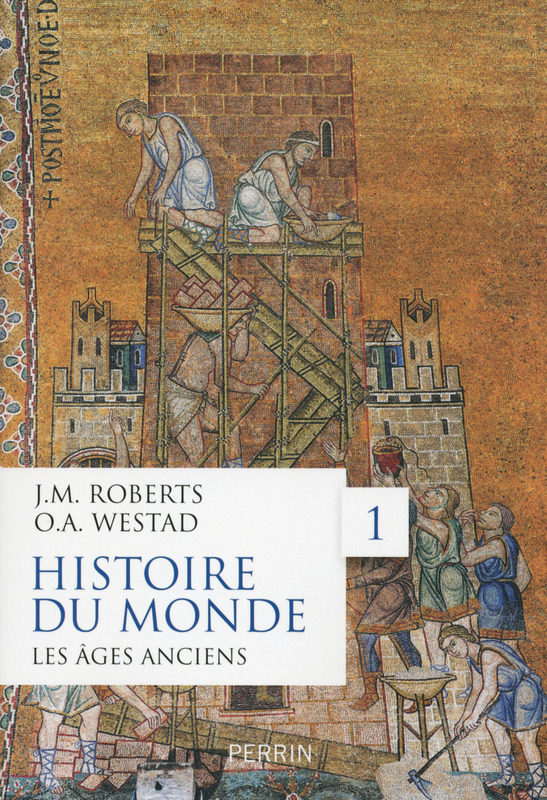
Un monument classique d’histoire ; « L’histoire du monde » de Roberts et Westad
La monumentale synthèse historique anglo-saxonne de J.M Roberts et O. A. Westad a été rééditée au printemps par Perrin. Elle fait apparaître de nombreuses modifications logiques, la publication reprenant les avancées scientifiques des dernières années, toujours dans un style simple. La démonstration historique est rigoureuse et malgré les nécessaires raccourcis qu’implique le genre, elle est d’une approche aisée et, lançons-nous, elle peut constituer une belle lecture d’été !
[rating=5]
Une Histoire classique du monde
La synthèse historique proposée ici est classique en ce qu’elle est rigoureusement chronologique. Trois tomes (les temps anciens, le Moyen Âge et l’époque moderne, le monde contemporain) traitent de l’apparition de l’humanité et de l’histoire, les deux étant en partie déliés, au temps présent. On remarque que les auteurs ne sont cependant pas prisonniers des césures classiques comme 1492 pour le passage aux temps modernes et ils usent souvent du temps long se jouant des dates-clés pour expliquer les mouvements macro-historiques. Ils donnent ainsi parfois en une dizaine de pages le sens d’une révolution pluriséculaire comme le néolithique tout en replaçant ses limites et les perspectives apparues à son propos depuis la fin du XXe siècle : ainsi, il constitue bien une « révolution » même si le terme est mis dans la balance ici, mais il ne doit pas occulté qu’il a pu être préparé par des hommes et en des lieux bien plus divers que ce qu’on a pu croire, le Croissant fertile n’étant pas un centre à considérer comme isolé. De même, on comprend que l’homme qui s’impose à l’échelle mondiale a pu être « hybridé » avec son homologue néandertalien alors qu’on a longtemps cru que les deux espèces s’étaient croisées sans se rapprocher. De même, l’histoire du Moyen Âge est largement revivifiée par l’importance que donne l’ouvrage aux peuples du Nord, les Vikings et leurs avatars, pour comprendre l’évolution de long terme de l’Europe, et peut-être même certains embryons d’Etat qui existent encore aujourd’hui sur le continent. Sans négliger les événements clés qui peuvent symboliser un changement d’époque ou un basculement, cette Histoire du monde permet de comprendre les grandes évolutions qui se déroulent sur des décennies, et surtout des siècles.
Cette synthèse peut ainsi ne pas être prisonnière de certaines règles (qu’on apprécie tout de même !) de l’écriture de l’histoire en France : les auteurs se permettent des comparaisons entre événements et sociétés avec des siècles de distance, la réflexion sur le temps présent en fin de tome 3 n’est pas escamotée, il est possible comme « d’anticiper » des événements historiques en proposant des allusions au futur du présent étudié… Les grandes périodes étudiées permettent aussi quelques libertés avec le positionnement classique de l’historien qui ici se positionne en surplomb et peut ainsi présenter une étude du Moyen Âge comme « tirée » vers les temps modernes, comme s’il n’était là que pour les préparer. Il redevient ainsi cette période de transition qu’on a longtemps enseignée.
Difficultés en vue d’une histoire désenclavée à partir d’une perspective occidentale
Evidemment, un monument de cette ampleur ne peut être exempt de quelque déficit. Ainsi, au chapitre des critiques, on reprochera l’absence d’histoire connectée. Aujourd’hui, il est évident pour l’historien qu’il faut étudier un phénomène sans l’isoler et que comparer et relier les phénomènes éloignés pour voir comment ils s’influencent peut permettre de mieux restitué le passé. Cette histoire connectée a émergé particulièrement avec l’étude de la première mondialisation que S. Gruzinski identifie avec la conquête ibérique du Nouveau monde. Si cette approche est incluse dans la réflexion, elle ne l’est que peu et est plaquée. En effet, la première version de cette histoire classique avait été construite avant cette innovation de la réflexion historique, et il aurait fallu reconstruire des chapitres entiers, ce qui aurait nécessité une réécriture complète des Temps modernes notamment, ce qui n’est pas ce qui a été privilégié ici. De même, l’histoire du Monde est d’abord ici une histoire de l’Occident, européo centrée. L’Afrique et même l’Asie du Sud-Est sont toujours périphériques et l’Afrique ne semble « entrer dans l’histoire » qu’avec l’accélération de la colonisation, même si quelques pages évoquent très brièvement les Etats africains médiévaux. De même, quelques simplifications inhérentes à la synthèse peuvent gêner : Byzance présentée essentiellement sous le trait de l’autocratie permanente par exemple… Surtout, il n’y a aucun élément sur les sociétés et civilisations précolombiennes ou sur les mondes pacifiques. Ces aspects demeureront étrangers au lecteur. Pour autant, les laisser de côté permet aussi de « tenir » un projet qui peut donner lieu à un livre grand public et pourtant exigeant sur le plan de la réflexion historique et de plus agréable à lire. C’est une gageure ; elle fut menée à bien pour la première édition et cette réédition confirme la valeur de ce grand classique comme le sont les Malet et Isaac, mais toujours d’actualité !
Visuels et informations ouvrages :
ROBERTS, JM, WESTAD, AO, Histoire du monde, tome 1 : les âges anciens, Paris : Perrin, janvier 2016 : 450 p. – ISBN : 9782262047160 – 22 euros.
ROBERTS, JM, WESTAD, AO, Histoire du monde, tome 2 : du Moyen Age aux temps modernes, Paris : Perrin, février 2016 : 450 p. – ISBN : 9782262047177– 24 euros.
ROBERTS, JM, WESTAD, AO, Histoire du monde, tome 3 : l’âge des révolutions, Paris : Perrin, mars 2016 : 548 p. – ISBN : 9782262047184 – 24 euros.