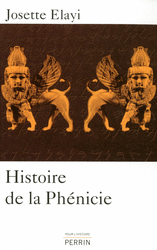
L’histoire des cités phéniciennes chez Perrin
Josette Elayi livre une histoire de la Phénicie préhistorique et antique aux éditions Perrin, manuel généraliste permettant de resituer le parcours de cités-Etats bien moins connues et fouillées que leurs homologues grecques. Si l’ouvrage permet de donner une chronologie très accessible des Phéniciens, aucun éclairage précis sur les cultures de ces micro-Etats n’est réellement développé. On reconnaîtra donc surtout l’intérêt et l’utilité de ce qui est une des rares synthèses en français de cette partie de l’Orient antique.
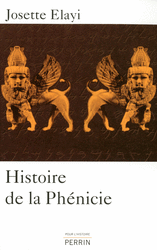 Des acteurs secondaires mais toujours présents de l’histoire levantine
Des acteurs secondaires mais toujours présents de l’histoire levantine
Les Phéniciens ne sont pas un peuple à proprement parler mais forment un agrégat de groupes sociaux puis politiques et culturels probablement originaires de l’arrière-pays de la Coelé-Syrie au sens large, c’est-à-dire la Syrie creuse et l’arrière-pays levantin. Ils étaient d’ailleurs pour E. Renan des troglodytiques, marque indélébile de leur obscurantisme selon le traditionnel déterminisme géographique du XIXe siècle… J. Elayi, spécialiste de la Phénicie perse, cherche à dresser leurs parcours encore mal renseignés, et ce particulièrement dans l’historiographie et l’archéologie françaises, bien plus tournées vers les aires antiques hellènes et égyptiennes. La synthèse politique générale dresse donc les principaux traits de l’histoire phénicienne depuis les premières traces de l’homme livrées par l’archéologie jusqu’à la conquête d’Alexandre.
On peut résumer brièvement cette épopée que l’on ne retient généralement que par le biais des comptoirs méditerranéens et particulièrement de Carthage la tyrienne, concurrente déchue par Rome lors des guerres puniques. La principale constante de cette histoire d’environ deux millénaires est la cité-Etat. Les cités phéniciennes sont comparables aux cités grecques : elles regroupent une ville quasi systématiquement côtière regardant vers le large pour puiser ses ressources (Sidon, Tyr, Byblos et Arwad sont les plus importantes), un hinterland offrant bois (cèdre du Liban), minerais et céréales, ainsi que quelques flancs de montagne (lieux sacrés, de refuge…). Aucune cité ne parvient (ni ne cherche durablement) à unifier l’ensemble de ces voisines et depuis leur constitution jusqu’à la période séleucide, elles conservent largement leur identité, leurs institutions… Elles s’allient parfois contre les envahisseurs communs ou pour soutenir des puissances extérieures comme lorsque les flottes des principales cités soutiennes au long du Ve-IVe siècle l’empire perse. L’exception est sans doute l’alliance Tyr – Sidon et ce seulement parce que la première est assez puissante pour soumettre sa brillante seconde au VIIIe siècle. La règle est donc que chaque cité défend ses intérêts, à tel point que les puissances extérieures jouent souvent l’une contre l’autre : assez régulièrement, lorsque Sidon, Byblos ou Tyr se révolte contre la Mésopotamie ou l’Egypte, cette dernière favorise la concurrente locale. On a bien du mal à trouver quelque élément d’association politique ou économique à fondement même lâche culturellement comparable aux ligues grecques. Le seul cas est celui de Tripoli, ville symbole d’une « confédération phénicienne » pour le moins quasi fictive. Le nom phénicien de la ville est en réalité Atri. La ville n’est formée que progressivement à partir de trois comptoirs dépendant respectivement de Tyr, Sidon et Arwad. Elle est neutre et doit accueillir, lorsqu’une menace commune se dessine, des réunions des représentants des cités. Bien que les sources soient peu fréquentes, difficulté persistante pour l’ensemble de l’histoire phénicienne, l’auteur s’accorde avec le reste de l’historiographie pour considérer que ce siège n’a eu que très peu de rôle dans l’histoire levantine.
Il ne faut pour autant pas en conclure que les cités phéniciennes furent totalement secondaires dans les développements régionaux. L’histoire politique donnée par l’auteur rappelle combien ces cités furent riches de par leur capacité à innover (navigation, urbanisme avec les plans hippodamiens avant l’heure, textile avec la pourpre, travail du bois…), leur capacité à coloniser et à se projeter sur toute la Méditerranée et grâce à leur situation au contact des grands ensembles politiques de l’antiquité (Egypte, Hittites, empires mésopotamiens, systèmes égéens). Ces cités furent donc, à défaut d’être des puissances de premier ordre, des appuis aux ressources décisives pour les grands empires, ce qui explique que bien souvent, leur autonomie fut préservée étant plus utiles comme points de relai d’une autorité mettant à disposition leur flotte et leur richesse commerciale plutôt que comme ville sujette se révoltant aisément car située dans ce véritable fossé d’effondrement des empires que fut la Coelé-Syrie et plus généralement le Levant antique. Ainsi Tyr, ville côtière mais aussi île fortifiée résista souvent aux envahisseurs (13 ans de sièges dans les sources bibliques par le babylonien Nabuchodonosor II).
Au final, les cités phéniciennes parviennent à conserver une autonomie plus ou moins prononcée sur le long terme depuis le IIe millénaire alors qu’elles émergent jusqu’à la fusion au sein des monarchies hellénistiques aux IIIe – IIe siècles.
Une démarche purement chronologique
Josette Elayi choisit une structure uniquement chronologique au détriment d’une approche proprement analytique et reflète en cela ce qui est la démarche de l’historien de l’antiquité en France. L’archéologie définit la formation des habitations humaines durables dans les sites entre 3000 et 1200 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens sont issus comme les autres peuples de la région de plusieurs mélanges. Mais les cités comme ensembles politiques clairement constitués apparaissent clairement dans les sources écrites, bibliques et l’archéologiques avec la fin de l’âge de Bronze. Byblos est sans doute la plus ancienne et existe déjà par son commerce du bois avec l’Egypte dès le IIIe millénaire (quelques traces dès le IVe millénaire). Elle est longtemps importante grâce à ses proximités religieuses avec le puissant voisin du Sud. Tyr suit ainsi qu’Arwad et les autres. Les cités phéniciennes apparaissent déjà comme des enjeux stratégiques dans l’affrontement entre Hittites et Egyptiens avant que ceux-ci ne s’effondrent sous les coups des « peuples de la mer ».
Les cités phéniciennes, sans cesse en concurrence commerciale, parfois guerrière, bénéficient de ce déclin après les XIIIe et XIIe siècles. Elles peuvent alors développer un écosystème qui leur est propre avec des systèmes généralement royaux mais faisant la place à des institutions de type démocratique ou oligarchique (ce sont selon plusieurs sources antiques ou si l’on suit la constitution carthaginoise des « constitutions mixtes »), des sociétés foncièrement commerciales, polythéistes mais aussi hénothéistes (le dieu « national » ou civique est le dieu protecteur primant sur les autres, tel Baalat, équivalente à Byblos de l’Hathor égyptienne). Elles prospèrent à tour de rôle, Byblos et Tyr ayant particulièrement marqué l’histoire phénicienne. Ces siècles permettent de préparer l’apogée de la culture phénicienne que l’auteur identifie avec les Xe – VIIIe siècles et qui correspondent à la grande période de la colonisation. Chypre est déjà ponctuée de comptoirs tyriens depuis longtemps, dont Kition, devenant un point commercial et politique majeur du Ier millénaire avant Jésus-Christ. Les trirèmes levantins s’aventurent jusqu’aux confins méditerranéens en Espagne (peut-être même à Madère au-delà des colonnes d’Hercule). Leur domination commerciale trouve écho dans l’Odyssée. Surtout, les tyriens fondent au VIIIe siècle, selon Justin et par le biais d’exilés dirigés par l’ingénieuse Elissa. Carthage surpasse rapidement Utique et devient dès le Ve siècle une puissance majeure de la partie occidentale du bassin méditerranéen. Les phéniciens exportent leurs marchandises et leurs produits mais aussi leur alphabet depuis l’Egée jusqu’à la Mésopotamie et même en Egypte.
Les petites cités résistent mieux aux envahisseurs qu’ils viennent de la mer et de la terre mais passent successivement sous la coupe des grands empires. Après un léger rétablissement de la puissance égyptienne en Phénicie vers 1200 – 1100 avant Jésus-Christ, les cités sont pleinement indépendantes et sont les points focaux du commerce de la Méditerranée orientale et au Proche-Orient en général. Au IXe siècle, les Assyriens dominent progressivement la côte avant d’être remplacés par les Sargonides, les Babyloniens puis les Perses durant six siècles. Systématiquement, les cités survivent comme entités montrant leur formidable capacité de résilience. Elles paient tribut, elles font circuler les ressources et financent le centre du moment : au VIIe siècle, Sidon et Tyr, les deux plus puissantes, servent largement par leurs richesses les programmes de construction en Babylonie. On retrouve ainsi le cèdre libanais depuis les confins de la Transeuphratène jusqu’au Golfe persique et en Egypte. Lorsque l’une de ces deux cités se révolte avant d’être défaite par quelque expédition, le conquérant favorise sa concurrente qui profite de son pouvoir retrouvé pour se soulever et être réduite à son tour. Sous les Perses, les Phéniciens jouissant d’une autonomie assez appréciée soutiennent largement les Achéménides contre les Grecs qui sont leurs premiers concurrents commerciaux (on le voit par exemple lors de la répression de la révolte ionienne ou au début de la campagne d’Alexandre). Elles perdent d’ailleurs de leur puissance avec le recul de la puissance perse comme en atteste le déclin de leurs monnayages parmi les plus anciens du monde méditerranéen.
Le déclin de l’histoire phénicienne n’est donc pas celui de la perte de la puissance, puisque celle-ci se situe toujours ailleurs. Elle est celle de l’identité culturelle. Ainsi dès le Ve siècle, alors que Tyr ne pèse plus réellement depuis l’indépendance carthaginoise, on voit l’influence grecque se développer : certains rois portent des noms grecs (Straton…), les styles ioniens voire attiques pénètrent dans le Levant… A terme, ce n’est donc pas la conquête d’Alexandre (assez facile par ailleurs car bien accueillie le plus souvent, à la brillante exception de Tyr prise à la suite d’un siège) qui menace la Phénicie mais l’hellénisation qui se généralise sous les royautés lagides et séleucides.
Des productions culturelles et spirituelles difficiles à cerner
L’histoire développée est essentiellement événementielle et servira aisément à ceux qui cherchent à commencer une étude approfondie du Proche-Orient antique. Mais on déplore le peu de relief historiographique et de confrontations de sources sauf pour le cas de la période perse. Les points généraux et l’analyse thématique sont ainsi particulièrement absents. L’archéologie est de même très vite absente lorsque la proto-histoire est dépassée. Les débats archéologiques comme historiographiques sont ainsi quasi absents alors qu’ils traversent largement les champs de l’histoire levantine.
Le reflet le plus évident de cette démarche événementielle est que les aspects culturels, sociaux et économiques (les derniers étant pourtant très étudiés par les archéologues sur base des sigillées et céramiques) sont les grands oubliés du récit. Ils n’apparaissent qu’en fin de chapitres et sont évoqués souvent brièvement. Placer la fin de l’histoire phénicienne par la fin de la culture phénicienne est d’autant plus gênant que les aspects culturels sont bien peu traités hors de quelques focus sur la sculpture funéraire… D’ailleurs, à plusieurs reprises on croit plutôt lire une histoire générale du Proche-Orient antique plutôt où le propos est centré sur les grands empires plutôt qu’un développement prenant pour sujet principal les Phéniciens eux-mêmes. On trouve quelques exceptions : les épisodes de la vie de Bodashtart, la dynastie de Baalshillem ou la révolte des esclaves de Tyr. Le propos aurait û être enrichi des recherches de l’historiographie des mondes bibliques, auxquels les Phéniciens appartiennent partiellement. Pour approfondir ces aspects culturels et sociaux, on pourra se référer aux spécialistes des cultures anciennes du Proche-Orient, particulièrement les archéologues ou plus simplement à des écrits simples comme les volumes de la Nouvelle Histoire de l’Antiquité au Seuil.
L’ouvrage se veut une synthèse renseignée plutôt qu’un ouvrage universitaire gorgé de références et de notes de bas de page, le propos est rédigé très sobrement et donne donc à voir de manière très accessible ce que furent les évolutions politiques de ces cités-Etats mal connues en France.
Josette ELAYI, Histoire de la Phénicie, Paris, Perrin, 348, 23 euros. Sortie juin 2013.
Articles liés
One thought on “L’histoire des cités phéniciennes chez Perrin”
Commentaire(s)
Publier un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée.
Publier un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée.




![[Ciné Salé] Didier Nion lance Jérémie Lippmann, son Naufragé volontaire, à corps perdu dans le sillage héroïque d’Alain Bombard](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/521343/Sans-titre-1-222x150-c.jpg)

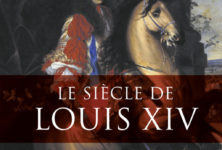
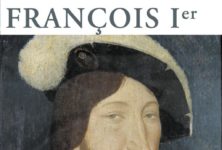
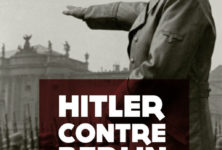





poier
bonsoir,
je suis un fervent admirateur de vos recherches sur la phénicie ,j’ai moi même FAIT UNE RECHERCHE PERSONNELLE de documents et JE PENSSE POUVOIR AMENER QUELQUES PISTES DE PLUS!
cordialement
luc.