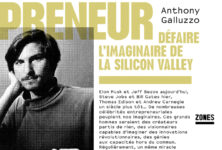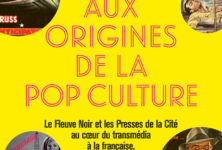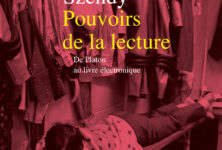« Aux origines de la pop culture » de Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux : Splendeurs et misères de la littérature populaire
Noble projet que celui de Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux aux éditions La Découverte : rendre visible l’histoire de la littérature populaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1990, en s’appuyant sur deux maisons d’édition iconiques, le Fleuve Noir et les Presses de la Cité.
Lorsque l’on parle de « paralittérature » ou de « littérature populaire », quelques noms surnagent : Frédéric Dard, Georges Simenon et Gérard de Villiers. Mais qui se souvient de Michel Lebrun, de Paul Kenny, de Kurt Steiner ? Toute histoire créée ses vainqueurs et ses vaincus, et l’histoire littéraire ne déroge pas à la règle : si certains auteurs continuent d’être lus, d’autres, qui vendaient pourtant des milliers d’exemplaires, sont maintenant oubliés. Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux s’intéressent à « l’histoire des livres que tout le monde a lus », analysant rapports de force, maisons d’édition, événements historiques car “l’histoire littéraire ne peut se penser isolée des histoires industrielles, économiques, techniques, culturelles et idéologiques qui lui servent de soubassement”.
Pour leur analyse, les deux auteurs centrent leur analyse sur deux maisons emblématiques : les Presses de la Cité, fondées en 1943, et le Fleuve Noir, en 1949. L’histoire commence donc juste après la Seconde Guerre mondiale, grâce aux nouveaux moyens de production qui permettent de produire des livres en masse (certains tirés à plus de 100 000 exemplaires !) et grâce à de nouveaux romans qui s’inspirent grandement de l’American way of life, tournés autour de genres emblématiques (espionnage, policier, science-fiction, érotisme…). Mettant en parallèle la Série noire dirigée par Duhamel, les deux auteurs montrent la spécificité des Presses de la Cité et de Fleuve Noir et mettent en avant quelques batailles que se livrent les éditeurs pour remporter des parts de marché.
La littérature populaire fait réellement partie de l’industrie culturelle (réseaux de distribution différents de la littérature traditionnelle, rythme de parution des titres également différent…). Les écrivains sous contrat doivent produire des ouvrages à un rythme effréné, et répondant à des demandes très précises censées répondre aux attentes du public. « Tous les auteurs racontent ce rapport très particulier à l’écriture que suppose le métier d’écrivain professionnel enchaînant les titres. Ils soulignent d’abord le caractère épuisant d’une telle astreinte. » Certains genres sont particulièrement vendeurs, comme l’espionnage, puisque ces romans reflètent une période particulière, celle des Trente Glorieuses, et le climat de la Guerre froide.
Si ces romans populaires sont particulièrement influencés par les Etats-Unis, Artiaga et Letourneux démontrent que les auteurs n’avalent pas bêtement la culture américaine, mais s’en réapproprient les codes. La production française se révèle si florissante que les livres se vendent dans le monde entier, exportant une certaine idée de la France. Entre 1979 et 1999, on trouve parmi les quinze auteurs de langue française les plus traduits dans le monde Georges Simenon et Gérard de Villiers.
Les auteurs se penchent enfin dans une cinquième partie sur la fin de la littérature populaire, de la critique radicale qui est faite de ces romans (notamment contestés par les idées véhiculées lors de Mai 68, alors que la majorité de ces romans étaient plutôt d’un bord conservateur) et la réinvention du genre policier, particulièrement par Jean-Patrick Manchette.
En plus d’être très clair et complet pour tout personne qui s’intéresse à l’histoire littéraire, Aux origines de la pop culture propose une riche iconographie en couleur : couvertures typiques de romans, correspondance entre auteur et éditeur, photos d’époque d’écrivains en séance de dédicace… Une radiographie d’une époque particulière, qui permet de remettre en contexte la pop culture actuelle.
« La structure des récits exprime clairement les raisons de ce sentiment d’une perte de maîtrise du sens. Elle tient tout simplement à une marginalisation croissante de la France sur la scène internationale, qui l’éloigne des pôles de décision et des lieux de crise. La manière dont les intrigues se nouent autour de l’espion en témoigne. L’agent secret est fréquemment français (Coplan, ou le Vicomte de Fred Noro), mais il est plus souvent encore étatsunien (comme Paul Gaunce de Laforest ou le Commander d’Arnaud). Et les Américains ne sont jamais loin dans des équipes qui sont largement atlantistes. Car si les intrigues mettent souvent en scène des Américains ou des Français pris dans le jeu des alliances, c’est parce que les crises internationales ne se règlent plus au niveau de la France. Ainsi, le paradoxe du nouveau roman d’espionnage « à la française », c’est qu’en contant les exploits de ses espions, il adopte une vision hexagonale du monde projetant sur les différentes parties du globe les sujets que mettent en avant les grands médias nationaux ; mais que, dans un même mouvement, il manifeste la marginalisation de la France sur la scène internationale dans une épopée collective où elle joue de plus en plus un simple rôle supplétif. »
Aux origines de la pop culture. Le Fleuve Noir et les Presses de la Cité au cœur du transmédia à la française, 1945-1990 de Loïc ARTIAGA et Matthieu LETOURNEUX, Editions La Découverte, 192 pages, 20 €
Visuel : Couverture du livre