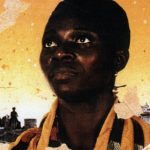Tigritudes, cycle qui invite à rencontrer le cinéma panafricain au Forum des images
En cent vingt-cinq films, ce cycle donne à voir les multiples visages du cinéma issu – au sens large du terme – du continent africain, en couvrant plus d’un demi-siècle d’art. A voir jusqu’au 27 février.
Réunissant des films tournés entre 1956 et 2021, le cycle Tigritudes veut tenter d’exposer des œuvres appartenant au cinéma panafricain qui furent pour certaines particulièrement sous-diffusées. Issus de quarante pays, les travaux rassemblés dans la programmation par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf, en collaboration avec le Forum des images, ont aussi pour ambition de laisser voir la variété des formes imaginées par les cinéastes du continent africain et de sa diaspora.
Au cours du mois de février 2022, le programme invite donc ainsi à voir ou revoir des œuvres du très remarqué Abderrahmane Sissako, du plus confidentiel Zeka Laplaine… ou encore de Rabah Ameur-Zaïmeche, immense réalisateur. Avec aussi un cours de cinéma de Jihan El-Tahri intitulé “Histoire du documentaire politique panafricain” le 18 février, ou un autre titré “Les cinémas lusophones d’Afrique, dans la tourmente des conflits” donné par Pedro Pimenta le 25 février.
Mortu Nega de Flora Gomes
Parmi les propositions programmées en janvier figurait notamment Mortu Nega, signé en 1988 par le réalisateur de Guinée-Bissau Flora Gomes. Sorti en France en mars 1990, il a la particularité d’être un film de guerre, qui situe son action en 1973, alors qu’une bonne part de la population du pays affronte les soldats portugais. Le premier parti-pris qui le rend étonnant est l’atmosphère écrasée de soleil, de végétation et de calme apparent qu’il plante via son décor, tout à coup brutalement perturbée par une explosion de mine, une chute de bombe ou un hélicoptère avec tireur. Il campe le conflit à hauteur d’homme, sans emphase.
Ce faisant, il fait d’autant mieux ressortir les différents sentiments éprouvés par ceux qui le vivent. Chefs paraissant jeunes pour la tache qui leur incombe, femmes se prêtant avec courage et calme apparent à ce combat, adolescents : tous sont rendus proches par la mise en scène, qui demeure au plus près des objectifs qu’ils doivent remplir. Une fois la lutte terminée, le film fait plonger son spectateur dans la nouvelle société qui tente de se mettre en place, avec difficulté. Sa force, à ce moment, est de poser des questions plutôt que de montrer de façon appuyée : des interrogations quant à l’esprit d’unité et de camaraderie, notamment, dur à maintenir.
Débat plein de vie, avec l’ombre d’Amilcar Cabral
Lors du débat suivant la projection, une ombre a été abondamment convoquée : celle d’Amilcar Cabral, fondateur du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (ou PAIGC) – qui comptait dans ses rangs les combattants décrits dans le film – assassiné en 1973. Avec par exemple, le réalisateur ango-portugais Joao Viana, présent ce soir-là, racontant ses souvenirs du cinéaste Flora Gomes, et expliquant notamment que c’est Cabral lui-même qui a désigné ce futur signataire de Mortu Nega pour exercer la profession de filmeur d’images. Ou l’historien franco-béninois Amzat Boukari-Yabara expliquant, lui, qu’Amilcar Cabral est devenu ingénieur agronome afin de pouvoir affronter la question de la terre, centrale pour son pays.
Un débat animé par Saad Chakali, rappelant lui que Cabral insistait sur la dimension culturelle de la résistance. Avant d’évoquer également des travaux cinématographiques récents qui tentèrent, eux aussi, de cerner de célèbres figures en lutte comme Thomas Sankara ou Frantz Fanon. Quelque part, c’est un sentiment de rencontre avec plusieurs personnalités, dans le film, devant l’écran, et dans les propos tenus lors du débat, qui ressort de cette séance, et paraît devoir habiter tout le cycle.
Le cycle Tigritudes se poursuit jusqu’au 27 février dans les salles du Forum des images, à Paris. Informations et réservations : https://bit.ly/3olYrOY
Visuel 1 : affiche du cycle Tigritudes
Visuel 2 : détail de l’affiche de Mortu Nega lors de sa sortie en France en 1990