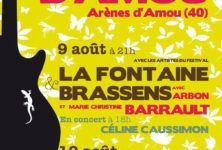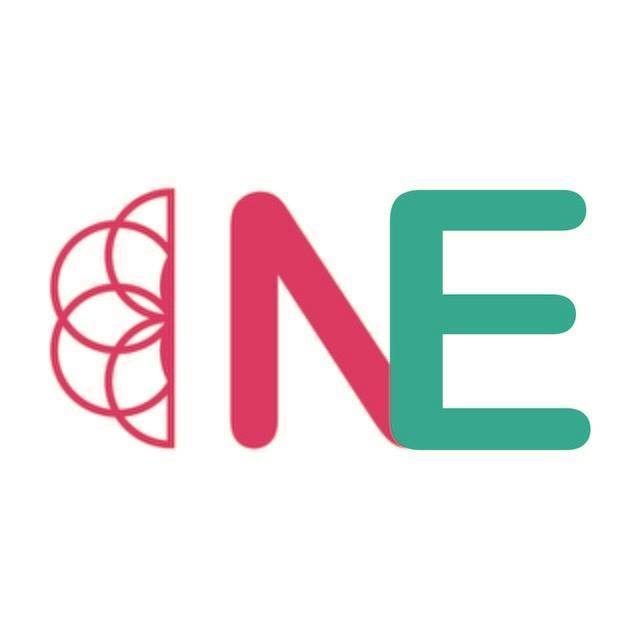
Entretien : Nouvelle Ère, l’association qui revendique à travers la démocratisation de la culture “la jeunesse des territoires comme ciment du lien social”
Nouvelle Ère. Tel est le nom de l’association de la jeunesse qui s’engage, pour ce qu’il est désormais convenu d’appeler les territoires, en menant des actions de proximité. Écologie, solidarité, proximité : son objectif est de mobiliser les jeunes pour bâtir des réponses à la crise sociale, écologique, économique et démocratique. Au sein de ce projet ambitieux et salutaire, la culture occupe une place de choix. Esther Gasque et Nicolas Le Bot – tous deux chargés de la diffusion, de la valorisation et du soutien de la culture au sein des territoires – ont accepté d’exposer pour Toute La Culture les contours et les ambitions de cette aventure associative détonante et, espérons-le, prometteuse.
Pour commencer, je souhaiterais que vous nous fassiez un panorama de l’association Nouvelle Ère : ses raisons d’être, ses membres, l’origine de sa création, ses actions et, bien entendu, ses ambitions pour le long terme.
Nicolas Le Bot : Vous l’avez déjà bien évoqué dans votre introduction. Nouvelle Ère est l’un mouvement de jeunesse politique, citoyen. J’insiste sur le fait que c’est un mouvement pleinement indépendant des partis politiques. Il a été fondé à la fin de l’été dernier, à l’initiative d’un groupe d’amis assez large. Aujourd’hui nous sommes un peu plus d’une centaine de membres répartis en douze délégations territoriales. Nous avons tous des profils assez divers ; beaucoup sont étudiants, mais dans des domaines variés : langues, droit, communication ; et il y a aussi des actifs parmi nous, dont une infirmière et une personne issue du milieu associatif.
Esther Gasque : Notre action s’incarne autour de deux grands axes. D’un côté, et nous insistons fortement sur ce point, nous menons des actions de proximité. Ce peut être des actions de court terme – nous avons organisé, par exemple, un café-débat à Annonay ainsi que des ateliers de débat au sein de la délégation Nouvelle Ère de Chalon-sur-Saône. Il y a également des actions de proximité de plus long terme, et je pense notamment à tout le travail que nous faisons en termes d’accompagnement de travaux d’intérêt général dans l’Hérault, à côté de Béziers. Nous avons également mis en place un jardin participatif à Trappes, dans la délégation des Yvelines. Voilà pour les actions concrètes que nous réalisons !
Par ailleurs, l’autre grand pan de notre action est de faire remonter des propositions des citoyens et des acteurs locaux – encore une fois, nous insistons sur ce tissu associatif qui nous est particulièrement cher – et de créer des ponts entre les territoires, qui peuvent s’inspirer mutuellement sur certaines initiatives particulièrement innovantes. Nous allons essayer, par ces propositions, de les faire peser dans le débat national. Il s’agit de promouvoir une vision qui concilie, à la fois, le projet et la proximité avec toutes les problématiques qui concernent l’emploi, les services publics, l’écologie, l’économie, la consommation, les lieux de sociabilité proches de chez soi.
Voilà les deux grands pans de notre action. Il s’agit d’actions concrètes en essayant de mobiliser la jeunesse autour des différentes propositions énoncées plus haut, pour ensuite jouer vraiment ce rôle de relais de propositions du local au niveau national.
NOUVELLE ÈRE ET SON PROJET POUR LA CULTURE
Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse aujourd’hui et qui occupe une place importante au sein même de votre projet associatif : la culture comme service public accessible à toutes et tous. Pouvez-vous nous éclairer sur la place que cette dernière occupe au sein de votre mission associative ?
E.G : Il faut savoir que la culture s’est inscrite très rapidement au cœur de notre réflexion, notamment en raison du lien et du travail direct que nous entretenons avec le tissu associatif implanté dans nos délégations locales. La culture est centrale dans l’engagement citoyen. Elle fait partie intégrante de la vie quotidienne des gens. Et comme nous avons cette volonté de partir du quotidien pour faire remonter certaines propositions, c’était extrêmement important ! Il est indéniable qu’elle participe à créer du lien social. Pour autant, il ne faudrait pas oublier qu’elle est aussi la traduction de certains maux de notre société, notamment en termes d’inégalités. Nous avons eu ce constat – certes un peu naïf de prime abord – de dire que c’est dommage, car elle doit être un moyen de « raccrocher les wagons » entre les citoyens, mais aussi entre les périphéries et la capitale. Et c’était ce sur quoi nous voulions travailler.
Nous proposons pour cela des actions concrètes. Nous nous sommes déjà dit que nous voudrions être – et nous avons déjà commencé ce travail-là – une vitrine de l’existant pour mobiliser les citoyens : nous voulons vraiment partager et promouvoir les initiatives déjà présentes, promouvoir les artistes locaux, la scène régionale. À titre d’exemple, nous avons eu un entretien avec un festival landais qui s’appelle Musique à la Rue ; c’est une structure qui organise, chaque été, un festival avec de grandes têtes d’affiche et qui parvient à générer pas mal de recettes qui servent à financer, toute l’année, des activités culturelles à Luxey, un village landais de 700 habitants. Les organisateurs y gèrent une salle de spectacles au sein de laquelle interviennent des groupes variés dont des danseurs de l’Opéra de Paris. Je trouve qu’ils ont vraiment réussi à implanter la culture, à brasser d’autres formes culturelles. Le travail qu’ils mènent dans ce village, en se servant d’un événement-clé qui a lieu une fois l’année, est vraiment intéressant, de même que de se servir de ces recettes festivalières pour que la culture soit pérenne en région landaise. Pour preuve, la salle du spectacle fonctionne à plein, elle est remplie. Être vitrine de l’existant, c’est notre première volonté !
N. L B : C’est d’ailleurs en partant de ce constat que Nouvelle Ère a réussi à faire émerger ses idées principales. La première, c’est qu’il y a une vraie nécessité de pérenniser l’offre culturelle sur les territoires, c’est-à-dire que partout, tout le monde ait la possibilité d’accéder à une offre musicale, cinématographique, littéraire ou autre : bref, d’avoir un accès à toutes les formes de culture et ce, quelque soit l’endroit où l’on habite. La seconde a trait à la nécessité d’une démocratisation de la culture, car ce n’est pas le cas sur l’intégralité du territoire.
Démocratiser la culture, ça passe pour nous par le réinvestissement de lieux culturels qui existent déjà. Il faut savoir qu’en France il y a deux fois plus de bibliothèques que de bureaux de poste. Les bibliothèques sont des lieux culturels qui méritent d’être réinvestis pour pouvoir mener d’autres projets culturels en leur sein. Après, nous avons conscience que démocratiser la culture est une tâche extrêmement difficile. Mais, à son échelle, Nouvelle Ère veut s’investir dans cette mission en ayant conscience que c’est un travail de très longue haleine, qui sera compliqué, mais qui mérite que l’on s’y intéresse. L’objectif est de réussir à amener des populations diverses en lien avec des associations. Nous pensons par exemple à passer, pour cela, par le biais d’associations sportives qui s’adressent peut-être à un public plus éclectique ; ça permettrait de fuir l’entre-soi, d’avoir une démarche plus inclusive pour faire contribuer ces associations à des projets culturels et finalement réussir à porter des projets plus durables en termes d’offre culturelle au sein des territoires.
En partant de ces deux constats, nous avons réussi à faire émerger une proposition plus concrète. Nous aimerions réussir à repenser le concept des Maisons de la Culture telles qu’elles avaient été mises en avant par André Malraux. En faire des lieux polyvalents bien équipés en matériel professionnel et modulable les rendrait plus accessibles à toutes les associations et, ainsi, à tous les usages culturels en en faisant à une échelle intercommunale, l’échelle la plus logiquement resserrée sur les territoires, des vrais lieux de culture.
E.G : Pour rebondir très rapidement sur ce que dit Nicolas, nous insistons sur le fait que l’équipement des Maisons de la Culture doit être neuf, relativement de pointe, bref, à usage professionnel. Parce qu’investir dans cet équipement permet aussi de professionnaliser le secteur culturel présent sur les territoires, de pérenniser – et c’est important – le statut des intermittents du spectacle et justement de générer de l’emploi pour redynamiser les territoires. Avoir vraiment ces structures de pointes comme, par exemple, une salle avec une très bonne acoustique, permettrait aussi de faire émerger des résidences d’artistes qui pourraient, eux-mêmes, avoir une certaine influence sur le rayonnement des territoires.
Quelle(s) culture(s) pour les territoires ? Quelle importance ? Et, surtout, quels moyens de valorisation à l’échelle locale ?
E.G : Déjà, pour nous, la culture est indispensable au développement et au rayonnement des territoires, auxquels nous sommes attachés et pour lesquels nous avons réellement envie de nous investir. Pour cela, il faut que l’échange entre les différentes pratiques culturelles qui existent entre les différents territoires soit vecteur de lien social et, pour que ce soit une réalité, il faut que chacun et chacune, selon notre mouvement, se sente légitime de participer à cette communauté nationale. Selon nous, nous devons pouvoir valoriser toutes les cultures où qu’elles se trouvent ; c’est à notre sens le meilleur moyen de lutter contre les inégalités culturelles pour que la culture puisse émerger partout ! Pour préciser, la question est de moins opposer Paris et le reste des territoires. Ce serait vraiment la ligne de conduite du mouvement sur ce point-là.
N. LB : Un petit complément, peut-être, sur le terme « valoriser ». Par celui-ci on entend que culturellement, socialement ou politiquement, des événements culturels locaux qui existent doivent pouvoir être mis en avant autant que de grands événements qui sont déjà très plébiscités par le monde de la culture. Il ne faut pas considérer qu’il existe plusieurs formes de cultures qui soient opposables. Bien au contraire ! Elles doivent toutes coexister. Et la culture populaire est un vrai levier pour réussir à retisser du lien entre les citoyens. À la question de savoir comment valoriser les diverses formes de culture dans les territoires, nous savons que la PQR (Presse Quotidienne Régionale) met déjà beaucoup en avant les événements locaux, et peut-être qu’il faudrait pouvoir s’en inspirer pour réussir à inspirer des initiatives locales. En un mot : il faudrait réussir à valoriser toutes les cultures et les rendre accessibles quelles qu’elles soient et où qu’elles soient.
“LA JEUNESSE COMME CIMENT DU LIEN SOCIAL”
Vous êtes tous les deux bien placés pour savoir que toute association, afin qu’elle agglomère encore plus de personnes, doit non seulement ébaucher un projet fort – le vôtre étant, nous l’avons compris, de valoriser et de repenser la culture comme bien commun à l’échelle des territoires et à l’aune des problématiques sociétales et politiques contemporaines – mais elle doit aussi pour cela parler au cœur des gens. Comment le dialogue s’installe-t-il dans les territoires avec les habitants ? Quels sont vos moyens de médiation et par quel(s) relais, éventuellement institutionnels, êtes-vous aidés ?
N. LB : Je suis entièrement d’accord avec vous. Au sens où ce qui est au cœur de nos valeurs et de nos actions c’est bien de réussir à créer du lien dans les territoires avec les habitants, et réussir à « parler au cœur des gens », c’est vraiment l’expression adéquate. C’est d’ailleurs pour cela que l’on a crée des délégations territoriales. Elles sont composées de jeunes dans toutes les régions. Ils connaissent particulièrement bien leur territoire, leurs atouts, leurs richesses, mais aussi, et indéniablement, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour réussir à parler au plus grand nombre, au cœur des gens comme vous le dites, il faut non seulement que l’on arrive à s’entourer du plus grand nombre de jeunes issus des territoires, mais qu’on parvienne également à connaître les attentes de chacun dans ces espaces et les projets qui y existent déjà, puisqu’il y en a et qu’ils méritent d’être mis en avant. Comment ? En se rapprochant des associations locales qui, elles, ont un vrai retour d’expérience concret en terme culturel. C’est ce que nous avons fait avec le festival landais Musique à la Rue, et c’est aussi ce que l’on essaie de mettre en avant dans tous les territoires. En ce qui me concerne, je fais partie de la délégation Nouvelle Ère du département de la Loire-Atlantique. Avec les membres de cette délégation territoriale particulière, nous essayons de contacter des acteurs culturels locaux associatifs. Je pense notamment au festival Les Escales qui organise chaque été un festival à Saint-Nazaire et qui fait un vrai et remarquable travail culturel qui permet aussi de démocratiser la culture, toutes les formes de cultures, puisque l’offre de ce festival est extrêmement large. Faire cela nous permet d’avoir un retour d’expérience qui nous permet par la suite de nourrir notre réflexion quant aux possibilités qui existent à l’échelle nationale.
E.G : Selon nous, il est très important de prendre conscience que les nécessités de chaque territoire ne sont pas les mêmes. En discutant avec Nicolas, nous nous sommes rendu compte que, par exemple, dans ma délégation des Landes, le problème était plus l’offre culturelle en tant que telle. Il y avait ce besoin d’y pérenniser l’offre culturelle, qui était déjà existante, mais qui peinait tout de même à se stabiliser. Alors que du côté de la délégation de Nicolas, l’enjeu était davantage celui de la démocratisation de la culture – avec des gens qui s’autocensuraient un peu plus par rapport à cette dernière. Tous les territoires n’ont pas les mêmes nécessités en termes d’accès à la culture ; c’est pour cela que nous avons eu besoin de les soulever, en nous appuyant encore une fois sur le tissu associatif, mais aussi sur la population qui a bien entendu ses propres attentes.
Nous n’avons en revanche pas de relais institutionnels. Justement, nous souhaitons nous faire le relais des propositions et des besoins des citoyens auprès des institutions. C’est en promouvant l’existant, les associations des territoires que l’on souhaiterait à plus long-terme influencer les politiques publiques. Mais nous n’avons pour l’instant pas de relais institutionnels qui nous aident dans notre action. Notre relais institutionnel, c’est la citoyenneté. Et c’est en ayant à la fois la connaissance, mais aussi, et c’est c’est très important, la confiance des gens que l’on pense pouvoir favoriser le développement des politiques culturelles.
Le nom donné à votre association reflète un choix et, surtout, un sens qu’il me semble important pour tous et toutes de comprendre pour, peut-être, mieux saisir la portée de votre aventure associative : Nouvelle Ère de qui ? De quoi ? Pourquoi ?
N. LB : Nous sommes un mouvement de jeunesse, car nous pensons que les jeunes ont toutes les chances de pouvoir réussir à recréer le lien dans la société et à créer des dynamiques nouvelles. Si l’on parvient à réconcilier les jeunes avec l’engagement citoyen, on peut se demander si ce n’est pas la porte ouverte pour réussir à convaincre par la suite nos aînés à aussi s’engager. J’ajouterais aussi que dans les territoires – que ce soit les villes moyennes, les territoires périurbains ou la ruralité – la mobilisation des jeunes a souvent un impact. En menant des actions de proximité qui sont engagées par des jeunes et qui sont à destination de toutes et tous on arrive à créer du lien social, du plus jeune au plus âgé, et même entre ceux qui sont partis des territoires – mais qui y sont toujours attachés – avec ceux qui, au contraire, y sont restés. Au fond, Nouvelle Ère c’est la jeunesse comme ciment du lien social.
E.G : Quant à la question “Nouvelle Ère de quoi ?”, notre crédo c’est vraiment de remettre plus généralement la citoyenneté au centre du débat. Mobiliser tout le monde. Réinvestir le politique en partant des réalités quotidiennes des gens. La Nouvelle Ère, selon nous, c’est bien celle dont l’avènement est nécessaire d’un point de vue social, climatique, politique. C’est celle qui part et qui doit partir des territoires. C’est la même chose pour ce qui nous occupe aujourd’hui, à savoir la culture : nous devons créer des ponts entre les pratiques culturelles des différents territoires. Cela passe encore une fois par la valorisation des nouvelles pratiques culturelles ou de celles qui existent déjà – ainsi que par leur démocratisation.
Et enfin vous nous demandez pourquoi Nouvelle Ère. Il se trouve que, pour nous, les initiatives qui mêlent action de terrain et réflexion politique se font relativement rares aujourd’hui. Nous souhaitons à notre échelle pouvoir apporter cette méthode ascendante. Les partis politiques sont, on le sait, totalement désavoués aujourd’hui. On peut finalement se demander dans leurs cas : comment peut-on avoir une légitimité à plaider pour une démocratisation culturelle lorsque l’on n’obtient plus la confiance des citoyens en démocratie ? Ce constat de la déshérence citoyenne du politique est bien entendu à la base de notre réflexion, et c’est pour cela que repartir de l’essentiel en replaçant le citoyen au centre de notre projet politique nous paraît important. C’est pour cette raison que nous revendiquons, fortement, le nom de Nouvelle Ère !
Visuel © NouvelleÈRE







![[Chronique] Marie Gillain, femme forte dans les « Landes », sort en DVD](https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/fly-images/277852/DVD_LANDES1-222x150-c.jpg)