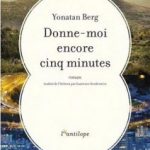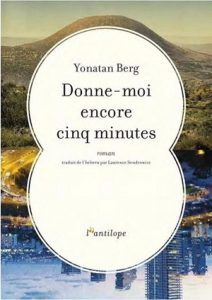
Donne Moi encore cinq minutes de Yonatan BERG
On imaginerait que Yonatan Berg met en accusation l’implantation dans laquelle il a grandi, mais à la lecture nous découvrons autre chose, de plus profond.
Berg nous parle de deux anciens amis de son implantation. Yoav a quitté la religion, enlevé sa kippa et a quitté sa famille pour Tel-Aviv. Comme un cliché Yoav étudie le cinéma, travaille comme barman et passe son temps à faire la fête et à consommer de la drogue. Il a une vie instable faite de petits boulots et de relations éphémères. Bnaya, le deuxième ami, contrairement à Yoav, est le modèle exemplaire de l’habitant d’une implantation religieuse, il est rabbin diplômé et éducateur, marié avec deux enfants et vit dans la communauté où il a grandi.
Au début du livre, Yoav évoque dans un mauvais trip le souvenir de la mort de son commandant dans une opération d’arrestation d’un suspect qui n’a pas réussi. Cette mort hante Yoav et l’empêche d’avancer. Mais il est déterminé à corriger sa vie, à accepter ce qui s’est passé et peut-être finalement à s’accepter lui-même.
Situé au centre d’une implantation près d’un village arabe, on supposerait un livre sur l’idéologie des colonies, mais la politique a un statut secondaire dans le livre. Donne-moi encore cinq minutes est un acte d’accusation délicat et captivant sur le mode de vie des religieux et sur ce que devient ce modèle sectaire lorsqu’il s’épanouit dans une géographie contrainte. Le livre est une confirmation littéraire de ce que le sociologue Ervin Goffman appelait asile.
Le roman feint le militantisme, l’éditeur lui-même a choisi de traduire dans son prière à insérer le mot implantation par colonie, mais l’implantation Psagot est en zone C et à ce titre ne sera jamais démantelée mais annexée. Il reste le geste littéraire. Berg parle de lui avec pudeur. On comprend qu’il est tous ses personnages et si l’émotion manque parfois son roman intime est une jolie balade dans une histoire multiséculaire et une géographie complexe.
Visuel :© L’Antilope