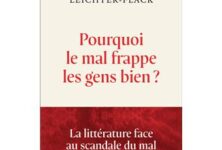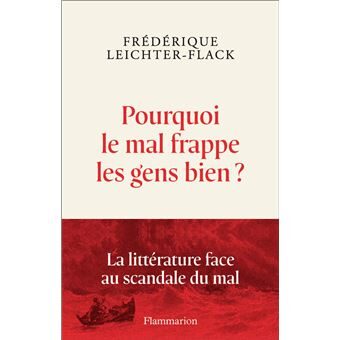
«Frédérique Leichter-Flack: Appréhender le mal avec à la littérature
Shakespeare, Thomas Hardy, Alexandre Dumas, Dostoïevski, Camus. Les plus grands écrivains se sont penchés sur le scandale du mal. Frédérique Leichter- Flack en fait la démonstration: la littérature peut nous aider à comprendre et à affronter le mal.
Le questionnement de la littérature face au mal
«Aux gens biens il ne doit rien arriver de mal». Frédérique Leichter-Flack commence son étude sur la littérature face au scandale du mal par le livre de Job. Job est ce juste sur lequel les malheurs vont pleuvoir. «Pourquoi lui»: la bible pose cette question dérangeante. Mais renoncer à la justice du monde, renoncer à «la rétribution» est presque impossible. Sans une fin «heureuse», l’histoire de Job devient insupportable. Le malheur ne doit pas arriver par hasard. Si les méchants ne sont pas punis, le monde devient un cauchemar , comme dans la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear. L’iniquité, le non sens d’une souffrance sans fond traversent dramatiquement la pièce. Tess d’Uberville vit «sur une étoile tachée», son destin est cruel. Dans le roman de Thomas Hardy, la malchance est structurelle, le pessimisme inexorable, les personnages ont une lecture fataliste du mal. Le Comte de Monte Christo apprendra tardivement que la vengeance n’est pas une solution, que rien ne peut vraiment réparer le mal fait aux victimes. L’auteure se range du coté d’Ivan Karamazov: pour lui rien ne peut justifier la souffrance d’un enfant, le scandale du mal ne peut pas se racheter. Avec la Shoah, un seuil a été franchi dans la longue histoire du mal et de son questionnement. Pour Edith Bruck la non intervention divine est une énigme, pour Zvi Kolitz, «Dieu s’est voilé la face». La Shoah remet de manière dramatique la problématique du mal au cœur de la théologie.
La beauté réparatrice de la littérature
Frédérique Leichter Flack enseigne à Sciences Po Paris, «La littérature et le problème du mal». La littérature pourrait nous aider à appréhender le problème du mal, en nous offrant «des expériences morales protégées». C’est la thèse centrale de l’auteure. Ce livre est un chemin en littérature qui voudrait être aussi une thérapie morale. Un voyage riche en enseignements philosophiques. Comme Jane Eyre, elle réfute la rétribution: tout malheur n’est pas mérité, soulageant ainsi la culpabilité des affligés. Elle insiste sur l’impossible complète réparation des victimes, mais il ne faut confondre l’infortune et l’injustice qui peut être en partie réparée. Prenant l’exemple des attentats du Bataclan, elle reconnaît l’horreur de la contingence comme être simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Elle revient sur la banalité du mal qui est indifférent à l’immense douleur qu’il cause.
L’essai de Frédérique Leichter-Flack est didactique. Très agréable à lire, il témoigne d’une grande capacité d’analyse de la littérature . Le lecteur pourra en être convaincu, la littérature peut nous aider à affronter le mal. Dans le contexte de la pandémie récente, la fiction en éclaire les enjeux sociaux, éthiques, moraux grâce à la Peste de Camus ou à Némésis le dernier roman de Philippe Roth. L’exigence éthique et le talent de Dostoïevski situent définitivement la littérature du coté de l’indignation. Et surtout la littérature ne prouve t’elle pas la beauté réparatrice des mots!
Frédérique Leichter-Flack, Pourquoi le mal frappe les gens bien? Flammarion, 256 pages, 21 Euros, sortie le 18 Janvier 2023.
Visuel:© Flammarion, couverture du livre