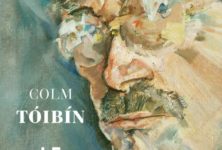Rentrée littéraire : la “gauche caviar” en vacances
Dans un magnifique palais de Marrakech, la Zahia, le narrateur se prélasse auprès d’un de ses amis et fameux intellectuel, Lewis ; il se souvient de son enfance, des femmes qu’il a aimées et des longues soirées d’été de la demeure marocaine… Un roman à clef pour raconter avec autodérision et amertume les vacances de la gauche « caviar ».
En grand ami du propriétaire, Lewis, le narrateur aime à entrecouper sa vie parisienne d’éditeur/journaliste/romancier pour se prélasser sur le balcon de la chambre qui lui est réservée à la Zahia, soit, en français, le « Palais de la Joie ». « La transparence de l’air, la fraîcheur mobile des patios, le parfum des buissons de roses chauffées au soleil », ce magnifique environnement a pour effet de transporter le narrateur « vers des plaisirs qui avaient appartenus à [son] enfance ». Heureuses ou non, ces images sont d’autant plus douloureuses que le temps file entre les doigts de l’écrivain. Pour conjurer cette fuite, vacillant entre désespoir et volonté de croire, l’homme se raccroche aux plaisirs qui s’offrent à lui : les amis, la douceur d’une soirée arrosée et surtout les femmes : des « petites amoureuses » qu’il va pêcher ici et là et, qu’en reines, il ramène à la Zahia ; des plus intrigantes parfois, comme Lavinia, l’italienne et ses yeux langoureux « aux couleurs d’une jeune pluie sur l’étang qui dort »…
Le regard jeté au dessus de l’épaule de la compagne du moment, le séducteur regarde mi envieux mi-moqueur, le « monothéisme amoureux » de ses hôtes, Lewis et Ariane. Qu’après vingt-ans de mariage, cette dernière « chante les louanges perpétuelles » de Lewis, qu’elle s’extasie « devant l’intonation de sa voix, [qu’elle regarde] dans la direction qu’il indique », subjugue notre Dom Juan, qui, au regard de l’équilibre et de l’optimisme dans lequel se maintient son ami, s’oblige à considérer le « monothéisme » sentimental comme une « hypothèse » valable… Intellectuellement tout au moins… Sur les femmes comme sur le reste, dans sa relecture de vie, le narrateur se dépeint comme l’opposé de son ami-hôte. Lui, en mélancolique contemplatif ; Lewis en actif qui s’étiquette “philosophe” : « Je chérissais mon nombril, et il conjurait une attaque terroriste sur Londres ou Djakarta ». Lewis n’est autre que Bernard Henri-Levy, la vaporeuse Ariane est Arielle ; ceux qui connaissent un peu l’auteur l’auront compris.
Quelle que soit la manière dont il s’agite, les hauts représentants de l’intelligentsia parisienne apparaissent, lors de leurs vacances marocaines, quelque peu désoeuvrés… Si glamour soit la Zahia et les gens qui la fréquentent, le désespoir suinte à chaque phrase. Or, faut-il le rappeler, Jean-Pierre Enthoven est journaliste, éditeur et écrivain… Aussi ses “phrases” sont-elles finement ciselées, parfois un rien affectées, toujours élégamment tournées. Le monde décrit est écœurant mais, avec force d’autodérision, l’auteur a la grandeur de le décrire sans le trahir : BHL est son ami, et à la fin de sa vie, jouant Frédéric Moreau dans L’Education sentimentale, ce sera bien vers lui que JPE se tournera pour conclure : « C’est là ce que nous avons eu de meilleur ! ».
Ce que nous avons eu de meilleur, Jean-Paul Enthoven, Grasset, 212 p. 15, 90 euros.
“Je résistais. Je m’agrippais. J’essayais de dilater le présent. Je cherchais la compagnie de ceux qui croyaient y parvenir. Je m’agitais en professionnel de l’allégresse ou de l’insouciance, mais cela ne dissipait pas le désarroi qui me gouvernait avec l’autorité d’une seconde nature. J’étais heureux et ce bonheur tremblait. Le soleil chassait mon inquiétude, qui ne s’envolait que pour m’attendre un peu plus loin.” (p 31)