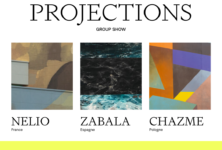Réclamer la terre, nouvelle saison au Palais de Tokyo
La nouvelle saison du Palais de Tokyo se place sous le signe de nos rapports avec la ”nature”. À l’exposition collective Réclamer la terre qui donne son nom à la programmation répondent sept expositions satellites, tournant de près ou de loin autour du même thème.
Reclaim, un écho à la clameur du monde
Pour l’exposition phare de cette programmation, le Palais de Tokyo a pu avoir le luxe de compter sur la sociologue australienne Ariel Salleh, l’une des plus grandes penseuses écoféministes actuelles et sur Léuli Eshraghi, chercheur-commissaire spécialiste des arts samoans et du Pacifique, dans le rôle de conseillers scientifiques. Tous deux ont pu apporter une expertise fine et précise sur les grands enjeux sociétaux contemporains et leurs expressions artistiques. Leur ancrage théorique dans un “matérialisme incarné” – conceptualisé par Salleh – donne tout son sens à l’exposition. Commissionnée par Daria de Beauvais, elle se dote d’une pluralité de voix, singulières et fortes. Le titre de l’exposition est une citation directe du premier recueil de textes écoféministes, Reclaim the Earth, paru en 1983 aux États-Unis. À l’instar de l’exposition, il regroupait des voix différentes et diversifiées, de femmes maories, de collectifs de femmes indiennes, sans oublier celle de Wangari Maathai, grand nom de l’écoféminisme kenyan et Prix Nobel de la Paix en 2004.
Invasions toxiques, les enjeux écologiques de la colonisation
À son arrivée, le spectateur est accueilli dans le grand hall par Cloud Chamber de Yhonnie Scarce, en résonance avec le poème “A Micronesian Woman” du recueil écoféministe. En effet, les dizaines de gouttelettes de verres suspendues dénoncent la déflagration qu’ont été les essais nucléaires en Australie réalisés par le Royaume-Uni de 1956 à 1963. L’installation apparaît de fait en écho au contexte français avec le même type d’opérations effectuées en Polynésie et dans le Sahara algérien, dont nous avons eu récemment un retour dans le présent avec les vents porteurs de poussière jaune… Plus loin, le spectateur découvre le saisissant panorama de Thu-Van Tran dont l’orange ne manque pas de faire penser à la contamination du Vietnam par l’agent du même nom. Flamboyant et inquiétant, il recouvre des photographies prises dans des plantations de caoutchouc amazoniennes ainsi que dans des serres tropicales, témoins de la volonté de colonisation occidentale. Attirant par son esthétisme, il nous rappelle aussi que notre maison commune, la Terre, brûle…
Parmi les quatorze participant·e·s internationaux/-ales, dont un duo et un collectif, nous retrouvons le travail de Daniela Ortiz, qui avait été un coup de cœur de l’exposition Not Fully Human à l’espace KADIST. Toujours aussi décapant, il met en scène de façon méchamment comique une revanche des graines et des plantes sur les colonisateurs, de connivence avec les victimes humaines de ces derniers. Au travers de ses peintures naïves, très narratives, se fait jour la belle idée d’alliances interspécifiques dans le but commun de renverser l’ordre colonial.
Expériences végétales
L’exposition d’Hélène Bertin, Couper le vent en trois, prolonge cette thématique du végétal. La jeune artiste française met en scène des sculptures organiques en dialogue avec ces objets de curiosité que sont les anatomies de végétaux. Il s’agit de représentations en 3D utilisées dans l’enseignement académique de la botanique depuis le XIXème siècle. Hyperréalistes, ils n’en dégagent pas moins un charme désuet. Dans une seconde salle, le spectateur retrouve toute une cuvée de vin élaborée avec savoir-faire et poésie en collaboration avec César Chevalier. Les outils nécessaires à sa fabrication y sont exposés comme des œuvres d’art, participant d’une déhiérachisation entre artisanat et art canonique. Chacun est traité minutieusement comme une sculpture et les bouteilles en verre soufflé prennent des formes inusitées. Elles semblent nous échapper. L’artiste qui vit dans le Luberon est attentive aux savoir-faire traditionnels. Elle a ainsi travaillé avec la céramiste Valentine Schlegel, décédée il y a tout juste un an maintenant, un maraîcher et plusieurs professionnel·le·s du vin. Pour l’occasion, les espaces du Palais ont vu leur toit s’ouvrir et devenir de véritables verrières pour laisser entrer une lumière zénithale.
Une autre exposition rentre dans cette même thématique du végétal puisqu’il s’agit de celle consacrée aux vingt ans du “Jardin aux habitant·e·s”. Créé à l’initiative de l’artiste Robert Milin, le terrain en friche en contrebas du centre d’art, rue de la Manutention, devenait alors jardin partagé. Lieu de rencontres et pivot de la création d’une communauté de jardiniers et de jardinières, il s’est fait terre d’accueil de plusieurs habitant·e·s de Paris et de sa banlieue alors sur liste d’attente pour avoir un petit lopin de terre. Robert Milin, intéressé par les “pratiques non expertes” des gens, présente deux décennies plus tard l’histoire de l’association via de modestes archives, aux côtés des portraits photographiques de cette communauté hétéroclite.
En sous-sol, au pied du grand escalier, le spectateur peut vivre une belle expérience immersive avec A Roof for Silence. Conçue par la grande architecte Hala Wardé, conceptrice du projet du Louvre Abu Dhabi, il s’agit ni plus ni moins que de la transplantation à Paris du Pavillon libanais de la dernière Biennale d’architecture de Venise. Hala Wardé y a fait figurer seize tondos de sa compatriote, la peintre libanaise Etel Adnan, disparue elle aussi l’année passée. Créant une atmosphère sonore particulièrement poétique grâce au Soundwalk Collective, l’installation a été également pensée avec le cinéaste Alain Fleisher qui reprend le motif de l’olivier de la peintre. Inspiré par leur côté architectural, il filme les arbres de nuit, insistant sur leur présence rassérénante et majestueuse.
Le chant de l’œdicnème bridé, des voix venues du continent australien
Originaire de Brisbane – nous notons du reste la forte présence d’artistes australien·ne·s pour cette saison –, l’artiste Megan Cope travaille à partir des questions de migration, de déplacement et d’extinction. Traversée en filigrane par la thématique de l’exil, puisque notre habitat semble se dérober, par pans, et de façon plus ou moins inégalitaire selon l’endroit du globe sur lequel nous nous trouvons, cette nouvelle saison vient mettre au jour des sujets brûlants et dérangeants. C’est bien de ceux-ci dont s’empare Cope avec Untitled (Death Song). Vaste installation qui s’étend au sol de la première salle de Réclamer la terre, elle donne à entendre le chant gémissant de l’œnicnème bridé, une espèce d’oiseau australienne menacée de disparition. Proche du son d’un bébé qui pleure, il émeut et semble appeller le spectateur. Peut-être l’enjoint-il d’agir ? de le sauver ? de faire quelque chose ? Mais quoi ? Le son reste suspendu, tout comme le sens de l’œuvre, activée ponctuellement par des musicien·ne·s qui viendront jouer une partition originale à certains moments non définis.
En pendant, sont accrochées au mur les acryliques de Judy Watson qui parlent du pays des Rêves des aborigènes. À la poursuite du sens des cartographies de ses ancêtres, la peintre en recréée de nouvelles. Ainsi, elle superpose la Seine, qui coule non loin du centre du d’art, aux ruisseaux de son Queensland natal. Se jouant de topographies impossibles et rêvées, la figuration fantasmée devient une abstraction poétique, créant presqu’un nouveau genre pictural. D Harding, quand à ellui, a réalisé une peinture murale avec la terre de ces mêmes ancêtres, cette terre ocre si reconnaissable, qui guide le spectateur depuis l’extérieur jusqu’aux espaces d’exposition. Les frontières entre dedans et dehors se retrouvent abolies puisqu’il s’agit de cheminer pas à pas, au travers d’espaces plus ou moins précarisés par l’air du temps, en suivant des traces de plus en plus difficiles à déchiffrer, recouvertes qu’elles sont par la poussière des activités extractivistes modernes… Et aussi, le centre d’art n’a jamais autant parlé d’extérieur. En effet, chaque œuvre se propose d’être une rencontre hors-les-murs, loin de la ville, et dans le même temps, une confrontation avec les questions les plus actuelles de nos vies contemporaines.
Esthétique des zones-frontières
Parmi les expositions satellites, c’est sans hésiter le travail de Laura Henno qui impressionne le plus. Articulé autour de trois films principaux, il offre la vraie la claque esthétique de la saison. Mélancoliques et puissants, ses rushes dressent un portrait en pointillé de jeunes Comoriens experts en zones-frontières, qu’ils soient passeurs par nécessité de survie ou migrants illégaux. Naviguant au sein d’écotones de l’obscurité, de la nuit et de l’inquiétude, ils ont la particularité de cohabiter et de se déplacer avec leurs meutes de chien. En ce sens, ils affolent et troublent. Ils ont ainsi pris pour habitude de formuler cette adresse aux passants craintifs : “Ge ouryao ! Pourquoi t’as peur”, qui donne son titre à l’exposition. Pour dialoguer avec les chiens, ils ont inventé un langage sifflé spécifique. Alors qu’elle vivait près de la forêt, ce sont ces sifflements qu’elle entendait la nuit qui l’ont interpellée nous raconte Laura Henno. C’est ainsi qu’elle a débuté ce travail remarquable, allant à la rencontre de cette communauté sifflante et errante, poussée par sa curiosité. Portée ensuite par une attention et une écoute affûtées, elle a su recueillir des fragments d’existence humaine et chienne, pourrait-on dire, d’une grande intensité. Un texte de Patrick Chamoiseau, L’instance du devenir, est publié pour l’occasion dans le dernier magazine du Palais de Tokyo. L’écrivain y rend un bel hommage littéraire à son travail visuel.
Visuels : Laura Henno, La Meute, Mayotte, 2018, C Print, 100 x 150 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles). Crédit photo : Laura Henno © Adagp, 2022 ; asinnajaq, Rock Piece (Ahuriri Edition), 2018, Vidéo, 4’02’’, Courtesy des artistes ; Laura Henno, Ge Ouryao ! Pourquoi t’as peur !, 2022, photogramme, film HD, 30’. Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles). Crédit photo : Laura Henno.