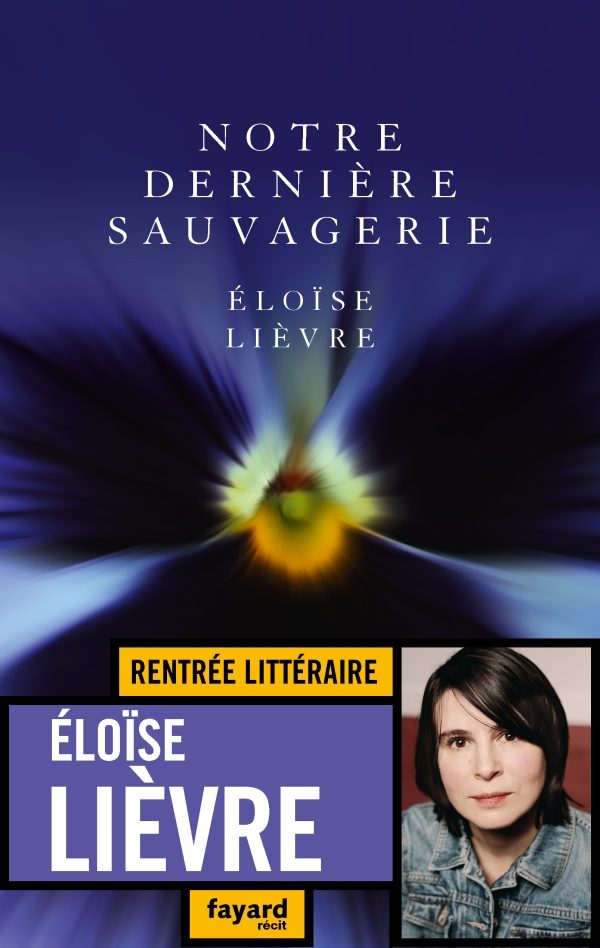
Notre dernière sauvagerie, le nouveau roman d’Éloïse Lièvre
Quatre ans après son dernier roman Les Gens heureux n’ont pas d’histoire, Éloïse Lièvre revient en cette rentrée littéraire avec Notre dernière sauvagerie. L’histoire d’une femme qui, à l’occasion d’une rupture, redécouvre et nous fait découvrir une sorte de fureur livresque entraînante, située à la croisée de l’intime et du politique : une hymne à l’objet livre ainsi qu’à toutes ses potentialités existentielles et politiques.
Votre roman met un scène un personnage qui dès le début, à la suite d’une rupture-douloureuse mais presque salutaire, décide de prendre en photo des gens qui lisent dans le métro. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie pour vous l’objet livre comme lieu d’établissement d’un rapport à soi et aux autres, et d’une brèche faite dans le réel ?
Le rapport à soi est étroitement lié au rapport à l’autre, il ne va pas sans lui. Et c’est effectivement cette idée qui domine le début de mon texte. J’écris essentiellement à la première personne et je revendique l’autobiographie, j’y reviendrai. Comment alors me prémunir contre l’égocentrisme et le narcissisme ? Par la conviction que je n’ai pas vraiment le droit de dire “je” à la place d’un autre, mais que ce “je” qui renvoie apparemment à moi est très humblement non pas le pronom d’une unicité mais au contraire de la reconnaissance d’une communauté, à la fois ressemblance et partage, avec tous les autres, mais aussi banalité. J’écris je parce que j’espère ne pas être différente, j’ose espérer que ce que je ressens est ressenti par les autres ou trouve un écho en eux. Prendre les gens qui lisent en photographie dans le métro était au début pour moi la mise en œuvre de ce sentiment : pendant une séparation conjugale, au cœur de l’expérience de la fin du couple, du noyau familial tel qu’il avait été originellement pensé et construit, renouer avec la multitude. Le livre est alors apparu comme le point commun, le trait d’union, je pèse mes mots, qui me reliait à tous ces inconnus, le signe de ralliement qui faisait de nous un groupe de semblables. Ralliement, parce que ensuite, cette idée a pris un tour plus politique. Il m’a semblé que cette confrérie de lecteurs dans le métro vivait d’une vie différente de celle que la marche du monde nous impose, qu’il pouvait donc incarner une forme de résistance à ce système. C’est peut-être ce que vous avez perçu pour parler du livre comme « brèche faite dans le réel », en tout cas, c’est ce qu’il me plaît de comprendre. Mais je pense qu’il faut être très précis avec cette vision de l’objet spécial qu’est le livre.
Inévitablement, je ne peux m’empêcher de vous poser la question “fatidique”: votre livre est-il une autofiction ?
Répondre à cette question va me permettre de revenir sur l’idée de « brèche dans le réel ». J’ai insisté auprès de mon éditrice, qui a aussitôt acquiescé, pour que la couverture de Notre dernière sauvagerie porte la mention récit et non roman. D’abord par honnêteté à l’égard des lecteurs. Je ne veux pas qu’ils soient déçus dans leurs attentes. En cela, non, ce texte ne relève pas de l’autofiction, genre romanesque, puisqu’il ne s’inscrit pas dans la fiction, en tout cas pas de manière traditionnelle. Comme pour mon livre précédent, Les Gens heureux n’ont pas d’histoire (Lattès, 2016), je revendique le genre de l’autobiographie. Mais là encore, il ne s’agit pas seulement de classer des œuvres, il s’agit de pouvoir exprimer mes conceptions de l’écriture, de la création littéraire, sinon plus largement de la littérature. Je suis mal à l’aise avec les catégories traditionnelles, qui confondent romanesque et fiction, poétique (l’adjectif) et poésie, qui assignent le poétique au poème, et qui surtout reposent sur l’idée qu’on saurait ce qu’est le réel, que LE réel existerait. Mon malaise débouche sur un certain nombre de convictions : toute écriture est écriture de soi, donc toute écriture (toute création même) est autobiographique ; la frontière n’est pas entre la fiction et la réalité mais entre le réel dans les livres, le réel des livres, et le réel hors des livres (d’où la remise en question des livres comme simples « brèches dans le réel », c’est plus compliqué que ça) ; de ce fait, dans ou plutôt pour, mais ce n’est pas tout à fait la bonne préposition non plus, Notre dernière sauvagerie, il me semble que j’ai déplacé la fiction, sa naissance, la création du fictif, dans la vie-même. La fiction a lieu quand je décide de prendre les gens qui lisent en photographie dans le métro, quand je convertis un besoin, un manque, en action farfelue, quand j’invente quelque chose dans ma vie, que je sors, dans ma vie, de l’ordinaire, pour fabriquer quelque chose. Ensuite, forcément, je n’ai plus besoin d’inventer, même si je continue d’imaginer, pour le texte, il n’y a plus qu’à raconter l’expérience, comme elle est vécue, et sentie, ce qui est encore un biais fictionnel, telle que je m’en souviens, ce qui est encore un biais fictionnel, car le temps est créateur de fiction. Ainsi, pour moi la fiction est dans la vie autant que dans les livres, et dans les livres, il y a autant de réel, et de la même nature, que dans la vie hors des livres. Tout se mêle et j’aime aussi cette confusion. Lorsqu’il a présenté mon livre dans Livres Hebdo, Olivier Mony a trouvé une formule qui m’a fait un immense plaisir : il a commencé par dire que c’était « un livre étrange » et a terminé en évoquant une « forme parfaitement impure ». Quel cadeau ! Et c’est là que la question du roman se repose, malgré ma volonté d’honnêteté et mes convictions : l’impureté, n’est-ce pas l’essence même du roman ?
Notre dernière sauvagerie, pourquoi ce titre ? Évoquez-vous la sauvagerie livresque comme à la fois puissance d’affrontement du monde et capacité de retrait vis-vis de celui-ci ?
Il peut sembler étonnant qu’un livre interrogeant la place du livre dans la vie s’appelle Notre dernière sauvagerie. Le paradoxe a d’abord pour but une réhabilitation du sauvage. Le sauvage, qu’on a réduit au primitif opposé au civilisé, et ainsi à la violence, c’est étymologiquement ce qui est relatif à la forêt. Or je pense qu’aujourd’hui, il y a plus de violence dans ce qu’on nomme la civilisation que dans les espaces où l’homme n’étend pas encore totalement sa domination, dont la forêt peut être l’emblème. Violence financière, sociale, violence à l’égard de tout ce contre quoi et grâce à l’exploitation de quoi la « civilisation » occidentale s’est bâtie, violence écologique donc. Ce que j’ai voulu dire dans ce livre, c’est que dans le système capitaliste mondialisant et mondialisé, fondé sur les impératifs de rentabilité et de profit, ce qui nous rattache encore le mieux à une autre manière de penser et de vivre, à un autre rapport au monde, c’est l’activité de lecture comme déchiffrement de signes et recherche de sens, et le livre comme objet magique. J’ai nourri cette idée de lectures d’anthropologues, Claude Lévi-Strauss, dont la pensée sauvage a inspiré le titre, Philippe Descola, Edouardo Viveiros de Castro, Edouardo Kohn, pour réunir le livre et les enjeux anthropologiques et écologiques. Lire est une forme de résistance, une désobéissance. Si lire nous extrait du monde pour nous plonger dans d’autres, lire nous engage aussi. Parce que le simple fait de lire est aujourd’hui une dissidence, une manière d’être à contre-courant des modes de vie et de pensée dominants l’Occident depuis la fin de la Renaissance. Bien sûr, j’entends lire au plus haut sens du terme, dans toute son inutilité, lire dans la splendeur de l’absence de productivité de cette manière d’être au monde. Lorsque nous lisons, nous ne produisons rien, nous ne consommons rien, nous ne gaspillons rien et nous pouvons changer de peau, de point de vue, être l’autre, nous sommes en tout cela plus proches des peuples animistes ou chamanistes d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, que de nos congénères occidentaux déterminés par le « naturalisme », c’est-à-dire la séparation insensée de « réalités » créées dans ce but même de division, la « nature » et la « culture ». Mais je vais encore plus loin : il me semble que nous renouons avec le sauvage propre de la forêt, avec l’animal, avec le végétal, parce que nous rompons même avec les données fondamentales de la perception de l’homme. C’est bien connu : lorsque nous lisons, nous ne sommes plus ni dans le même espace, ni dans le même temps que les lieux et les durées humaines, nous pouvons faire l’expérience de la géographie de la fourmi ou le temps du chêne séculaire. Contre toute attente, lire, c’est très post-humaniste, en fait.
Éloïse Lièvre, Notre dernière sauvagerie, 300 pages, à paraître le 19 août éditions Fayard 19 euros.
©Couverturedulivre









