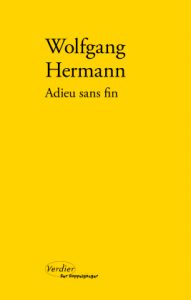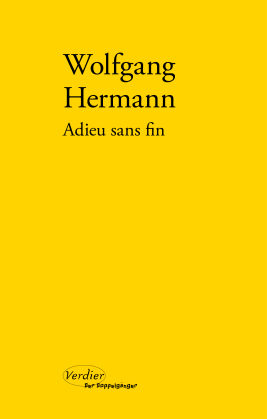
“Adieu sans fin” de Wolfgang Hermann, immortalité de l’écriture
Un matin, un père pousse la porte de la chambre de son fils de dix-sept ans et le retrouve mort dans son lit. Commence alors la douloureuse épreuve du deuil. Ce récit de l’autrichien Wolfgang Hermann traduit en français par Olivier Le Lay a la voix rauque des chants brisés. Un livre émouvant à la profondeur poétique.
Le danger en commençant la lecture d’un récit sur la perte d’un enfant est de se laisser aller à l’empathie – bien naturelle – avec le narrateur, et ne plus voir, sous l’effroi d’une telle épreuve, la richesse (ou la pauvreté) littéraire. Dès les premières lignes d’Adieu sans fin de Wolfgang Hermann, on comprend que la question ne se posera pas. L’écriture hyper-sensible, émotive vous touche en plein cœur, droit et net. Elle devient le moyen suprême de transcrire la moindre vibration d’une âme en proie à une peine inconsolable. Tout, du début à la fin, est question de lumière : celle vers laquelle l’enfant marche (image entrevue par le narrateur alors qu’il manque mourir, à son tour d’une tachycardie aigüe), celle qui sert désormais à mesurer le temps « j’avais perdu toute notion du matin et du soir. Il faisait clair, puis sombre de nouveau. » Si la lumière parcourt le livre, c’est parce qu’elle est ce vers quoi tendent, ensemble, main dans la main « comme avant » le père vivant et le fils décédé, ce vers quoi l’écriture aspire, ce qui va les relier pour l’éternité. Elle va son chemin, cette écriture, comme le narrateur qui retrouve celui de la forêt, des promenades méditatives, puis celui de la vie. Égrener des souvenirs, écouter Beyond the Missouri sky de Pat Metheny, pleurer avec les amis du fils ne permet pas de le faire revenir à la vie, mais de se raccrocher, toujours et encore à cette lumière, fuyante parfois, comme le temps. L’écriture sert parfois à en finir avec quelque chose, se sauver, fuir. L’écriture sert aussi parfois à prolonger, inscrire, rester. Le récit de Wolfgang Hermann en est une très belle preuve.
Wolfgang Hermann, Adieu sans fin, traduit de l’allemand (Autriche) par Olivier Le Lay, Éditions Verdier (collection Der Doppelgänger dirigée par Jean-Yves Masson), 2012 pour l’édition originale, février 2017 pour la traduction. 128 pages. 15 €
Extrait : “Je franchis le seuil de la maison. Le sol gravillonné vacillait sous mes pieds. Il n’y avait plus aucun appui stable. J’aperçus mon auto. Je n’arrivais pas à concevoir que j’aie pu la conduire un jour. J’emportais avec moi un cercle noir qui obscurcissait la lumière. Je retournai dans la maison, dehors j’étais sans défense. Je n’étais même plus capable de sortir seul. Mais la maison elle-même n’était plus la maison. Elle était un réceptacle du deuil. Les baies de fenêtre étaient des yeux crevés. Le plancher un squelette bringuebalant. La mort étendait aussi son empire sur les choses. Leurs bords s’estompaient, elles se liquéfiaient, perdaient toute consistance. Les choses étaient absurdes, elles l’avaient enfin compris elles-mêmes.
Un je-ne-sais-quoi maintenait pourtant la maison à sa place. Certes, elle s’enfonçait chaque jour plus profondément dans la terre, elle était aveugle et hurlait, craquait, grinçait et grondait comme jamais auparavant, mais au moins ne se disloquait-elle pas, en apparence en tout cas, les murs tenaient encore bon, même si la peur s’y engouffrait de toutes parts comme au crible d’une vieille toile d’araignée.”