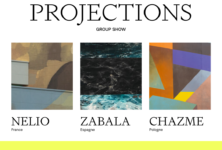Israéliens, Palestiniens riment avec artistes contemporains
L’art est un moyen d’expression, sans limite si ce n’est parfois celle de la censure. Israéliens et palestiniens doivent souvent créer en état d’urgence et dénoncer le réel avec la volonté de garder la tête froide, de solliciter l’empathie et la vision d’un monde pour le spectateur tout en restant fidèle à « l’acte esthétique »fondateur, la pulsion créatrice sans frontière. Etre un artiste aujourd’hui, en Israël et en Palestine implique-t-il nécessairement de faire de « l’art politique » ? La culture, la langue, les traditions sont-elles le sang des toiles, des sculptures, des installations ou des vidéos des artistes ? L’art peut-il aider à livrer une transcription différente du monde ? Deux artistes à la renommée mondiale, Sigalit Landau née en 1969 à Jérusalem et Emily Jacir née en 1970 à Bethléem, seront les figures artistiques de notre portrait.
La démarche, engagée et poétique de Sigalit Landau rend universelles des questions individuelles, philosophiques ou politiques. Pour y parvenir, elle associe souvent performances, installations, objets et films. Ses pièces ont la faculté de cristalliser en une image, un objet, des enjeux collectifs dont ses réalisations deviennent le symbole comme en témoigne par exemple l’immense notoriété de sa vidéo « Barbed Hula » ou elle apparaît, nue, sur une plage d’Israël faisant du hula hoop avec un cerceau en fil de fer barbelé. Son cerceau était fait de ces mêmes fils barbelés qui encerclaient hier les camps de concentration et marquent aujourd’hui les différents points de passage (checkpoints) entre Israël et la Palestine.
D’emblée, la référence religieuse marque, renvoie aux pratiques sacrificielles des origines des religions. Rituels, stigmates, propitiations, marquages indélébiles dans la lignée du body art cérémonial-cathartique des années 1960 et 70 à la Marina Abramovic, Gina Pane ou les actionnistes Viennois. Une représentation du corps violenté ou profané comme une expiation possible des corruptions de la société contemporaine. Sensible à la notion de frontière, dans cette perspective, le barbelé est emblématique du double mouvement métonymie de l’appropriation territoriale pour rallier le militaire et le civil, protéger mais enceindre aussi bien qu’il blesse. Une émouvante résistance à l’oppression, parvenant à jouer du dernier périmètre vital laissé par un espace politique et social astringent, une menace directe à l’intégrité physique de ses sujets.
Pour Emily Jacir, artiste travaillant entre New York et Ramallah, l’art est même « une question de survie ». L’absence, l’omission, la disparition et l’occultation sont des motifs obsédants chez Emily Jacir et on peut les retrouver pratiquement dans toutes ses œuvres. Cela va de son travail montrant des corps d’une revue de mode dont les nudités sont couvertes de noir, un peu comme la mère de l’artiste à chaque fois qu’elle prend l’avion pour l’Arabie Saoudite ; en passant par cette œuvre intitulée « Change » suivant le cours d’un billet de cent dollars échangé en francs français puis encore en dollars et ainsi de suite jusqu’à ce que, d’intérêts en intérêts, le billet de cent dollars ne vaille plus un centime. Une de ses œuvres les plus connues, intitulée Memorial to 418 Palestinian Villages Which Were Destroyed, Depopulated and Occupied by Israel in 1948, est une tente de réfugiés sur laquelle des volontaires ont été invités dans son atelier new-yorkais à broder les noms de villages palestiniens détruits par Israël. Lieu de mémoire transitoire pour un peuple forcé au nomadisme.
Dans « Stazione », à la fin du couloir on voit sur le mur faisant face aux visiteurs une horloge électronique qui ne marque pas les minutes mais les jours. Dès qu’elles parviennent à la date du jour, les aiguilles remontent le temps. Ces jours que compte l’horloge représentent la période pendant laquelle l’artiste Taycir Batniji n’a pas pu se rendre dans son atelier à Gaza. Une recherche de justice poétique basée sur un champ d’activités créatives rempli par l’interaction de forces en toutes apparences totalement contraires, telles que les qualités esthétiques de la poésie et l’aspiration à la justice.
Depuis plusieurs années, Sigalit Landau s’est engagée dans une relation approfondie avec l’endroit le plus bas du monde, la mer morte (-456 mètres). Réaction artistique, aux terribles particularités de ce site qui, théâtre-même d’une catastrophe écologique en cours, est un lieu blessé par l’histoire comme par l’actualité du Moyen-Orient. C’est l’endroit qu’elle a choisi pour développer une œuvre singulière, nourrie par son attirance continue pour le rituel, le corps mais aussi la mémoire qu’elle met en scène en concevant une sorte d’archéologie du présent.
« One man’s floor is another man’s feelings », le titre donné par l’artiste à son pavillon pour la biennale de Venise est une variation d’un dicton bien connu : « one man’s floor is another man’s ceiling ». Evocation de l’interdépendance entre les humains et le partage des richesses.
Les relations entre les deux peuples, la notion de frontière, sont toujours aux cœurs de ses recherches.
Autour du thème de l’eau, l’un des enjeux majeurs de la région, des énormes tuyaux aux couleurs du drapeau israélien, semblables à des pipelines, traversent le pavillon pour l’irriguer. L’eau comme le sang qui irrigue les corps, comme celle qui manque à un milliard d’humains, mais aussi la métaphore de la connaissance, du partage et des sentiments nous liant les uns aux autres et organisent nos destinés si loin et si proche Comme du sel qui se déposerait sur un objet ou sur une blessure, le parcours de Sigalit Landau cristallise les craintes et les espoirs de ces temps incertains.
Ce filet de pêcheur figé par le sel de la mer morte et désormais inutilisable, des vidéos, dont une réunion au sommet au cours de laquelle une petite fille se glisse sous la table pour attacher, les uns aux autres, les lacets des participants, les empêchant ainsi de quitter les négociations. Ces mêmes chaussures se retrouvent en ronde à l’extérieur, liées entre elles. Livrées aux quatre vents, comme l’étaient les chaussures des déportés, comme souvent celles des réfugiés, d’où qu’ils soient.
Pour son installation “Where we come from” (Là, d’où nous venons) Emily Jacir s’installe dans le centre culturel Tophane-i Amire, une fonderie de canons et une caserne bâtie en 1451. Photographies, textes, DVD se croisent. Le point de départ de l’installation et de l’action sur laquelle elle est basée se trouve dans la question suivante, adressée à des Palestiniens vivant en exile: “If I could do anything for you, anywhere in Palestine, what would it be?” (Si je pouvais faire quelque chose pour vous, n’importe où en Palestine, qu’est-ce que ça serait?) L’artiste exploite la liberté de mouvement (non sans danger) dont elle jouit grâce à son passeport américain pour réaliser les voeux exprimés et à sa portée.
“Va à Haïfa et joue au foot avec le premier garçon palestinien que tu rencontreras dans la rue. “
“Bois l’eau dans le village de mes parents.”
“Va à Bayt Lahia et rapporte moi une photo de ma famille, tout particulièrement des enfants de mon frère.”
“Va au bureau de poste israélien à Jérusalem et règle ma facture de téléphone.”
“Va sur la tombe de ma mère à Jérusalem le jour de son anniversaire, dépose des fleurs et prie.”
“Fais quelque chose un jour ordinaire à Haïfa, quelque chose que je ferais si j’y habitais maintenant. “
Dans son installation, Emily Jacir documente les voeux ainsi que les destins ou statuts des personnes les ayant exprimées; elle décrit ensuite ce qu’elle dû faire pour réaliser chaque voeux.
Créer c’est résister, si les territoires sont mal définis ou trop définis la langue, l’imagination, la transmission, les actes de créations ne doivent pas disparaître.
Toute une génération d’artistes palestiniens trentenaires, vivant ou non en Palestine, fait surface actuellement, notamment à l’occasion de Biennales et d’expositions collectives. L’artiste libanaise d’origine palestinienne Mona Hatoum, qui vit à Londres depuis 1975, a tracé la voie depuis une trentaine d’années. Pour la première fois en 2009 la Palestine a eu son pavillon à la biennale de Venise.
Ainsi, l’importante présence des femmes-artistes Jumana Abboud, Rana Bishara, Rula Halawani, Sandi Hilal, Noel Jabbour, Raeda Saadeh) atteste, bien évidemment, d’une évolution profonde des mentalités et de la société en intériorisant les violences de la guerre, en illustrant les conflits par des témoignages plus distanciés et plus mélancoliques, leurs œuvres paraissent souvent donner accès à l’autre côté du miroir, à cet ailleurs utopique où se résolvent, presque naturellement, les plus cruels paradoxes.
Dans le sillage du cinéma israélien, en pleine vogue, l’art pictural connaît à son tour un besoin de sortir du pays, les nombreuses galeries locales comme la Biennale ARTLV de Tel -Aviv ayant fait le plein d’acheteurs locaux. Une première exposition dédiée à Monaco ayant rencontré un public intéressé, il était logique qu’une maison de vente à son tour présente ces artistes, Ruven Kuperman, Jacob Mishori, Amnon David Ar, Nurit David, Barry Frydlender, Baruch Elron, Mika Drimer, Eil Gur Arie ou Doron Dahan, Boaz Arad ( tapis “Nazi hunter”) présents dans les musées israéliens, bénéficient d’une première renommée internationale.
Said Abu Shakra, ouvrira en 2016/2017 un musée dédié à l’art contemporain et à la culture Arabe et Palestinienne en Israël pour favoriser le dialogue entre Juifs et Arabes d’Israël. Les instigateurs du projet espèrent que le musée servira de lien entre des peuples et des cultures et deviendra une institution culturelle qui favorisera le contact direct.
Les artistes n’ont pas de pays si ce n’est celui de l’imaginaire, allez à la rencontre des rêves des artistes Israéliens, des songes des créateurs Palestiniens.