Michel Onfray : Faut-il brûler l’art contemporain ?
 Rebelle officiel et chouchou de la journaille, voici Michel Onfray. L’homme n’a, certes, pas que de mauvais aspects : son inclination de nietzschéen revendiqué à renverser les idoles est plutôt sympathique alors que la proverbiale « liberté d’expression » se résume souvent à l’expression « libre » des mêmes sottises et lieux communs que le voisin. Mais enfin, on le rangera parfois volontiers parmi ces penseurs médiatiques qui, à la façon de Pangloss de l’ère des mass media, s’échinent à faire savoir à qui-mieux-mieux leur avis sur tout… quand la sagesse ordonnerait de se taire. Exemple avec le double CD de sa niçoise conférence « Faut-il brûler l’art contemporain ? ».
Rebelle officiel et chouchou de la journaille, voici Michel Onfray. L’homme n’a, certes, pas que de mauvais aspects : son inclination de nietzschéen revendiqué à renverser les idoles est plutôt sympathique alors que la proverbiale « liberté d’expression » se résume souvent à l’expression « libre » des mêmes sottises et lieux communs que le voisin. Mais enfin, on le rangera parfois volontiers parmi ces penseurs médiatiques qui, à la façon de Pangloss de l’ère des mass media, s’échinent à faire savoir à qui-mieux-mieux leur avis sur tout… quand la sagesse ordonnerait de se taire. Exemple avec le double CD de sa niçoise conférence « Faut-il brûler l’art contemporain ? ».
Entre ici, cher public, et passe sous le fronton spinozien que grave solennellement Michel Onfray, juché en surplomb de toi : « Ni rire, ni pleurer, mais comprendre ». Et écoute bien. Ici, il ne sera pas question de « tomber dans le binaire » et les écueils : d’un côté les vestales de la « religion de l’art contemporain » et de l’autre, les « réactionnaires ». Non, car Michel Onfray est au-delà de cet imbécile clivage, qu’il a su repérer en vertu de sa haute pénétration d’esprit.
Écoute, public, écoute : « il n’y a pas grand monde dans le spectre intellectuel, philosophique français pour défendre l’art contemporain ». Et Onfray d’égrener son chapelet de noms : Comte-Sponville, Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry et Finkielkraut – dont aucun n’est pris au sérieux dans le monde de l’art… Ou l’art de se créer de dérisoires adversaires comme un boxeur se proposerait d’affronter des nains… N’importe si leur magistère en matière d’art n’est à peu près étendu qu’au lectorat du Figaro ou du Point – c’est dire…
 Il ne serait pourtant pas idiot d’exposer les arguments de ces opposants à l’art contemporain pour les contester. Et, à plus forte raison, ceux d’un Régis Debray, d’un Jean Clair ou du « dernier Baudrillard », qu’il se contente de balayer d’un revers de phrase sans plus d’examen, pour labelliser tout cela « réactionnaire », comme on jetterait indifféremment ses croûtes de pain dans la poubelle.
Il ne serait pourtant pas idiot d’exposer les arguments de ces opposants à l’art contemporain pour les contester. Et, à plus forte raison, ceux d’un Régis Debray, d’un Jean Clair ou du « dernier Baudrillard », qu’il se contente de balayer d’un revers de phrase sans plus d’examen, pour labelliser tout cela « réactionnaire », comme on jetterait indifféremment ses croûtes de pain dans la poubelle.
Mais enfin, passons sur cela. Passons aussi sur l’absence de définition de l’objet « art contemporain » (la datation ne fait pas l’unanimité chez les historiens de l’art, mais nous voyons grosso modo de quoi il s’agit). Passons encore sur cet oubli d’importance : la simple possibilité d’une critique radicale (et, par exemple, de gauche) de l’art contemporain qui n’appelle aucune nostalgie d’un prétendu ordre ancien, seulement l’exigence d’une nourriture pour habiter et combattre le présent(éisme), contempler le passé, envisager l’avenir. Passons sur toute absence de référence à des théoriciens importants de l’histoire de l’art moderne ou contemporain. Passons, passons.
Pour commencer, Michel Onfray donne d’abord un long résumé d’histoire de l’art (qui s’étire sur tout le 1er disque), s’attardant à raison sur ce passionnant, jubilatoire et trop méconnu épisode des Arts incohérents (les curieux et amateurs du dadaïsme iront lire à grand profit ce site consacré à ces précurseurs, gais persifleurs). Puis d’expédier les raisons du succès de l’art contemporain après Duchamp, éclairant à la lumière de son nietzschéen flambeau le mystère de cet éminent Sphinx du XXe siècle. Pourquoi pas ? Comme l’écrit Alain Boton (lisez donc cet excellentissime article), « à chacun son Duchamp ».
 Il finit par aboutir à un vague exposé de l’art contemporain, dont ne surnage en fait pas grand-chose – et il est certain que 1h30 de conférence ne permet pas de venir à bout d’un si vaste sujet. Clémence rengainée, évaluons le contenu de cette conférence. Que nous dit Michel Onfray sur l’art contemporain ? Quelle lumière celui qui s’est fait profession d’allumer des feux de joie au crépuscule des idoles peut-il apporter ? Va-t-il frapper les statues des idoles inquestionnées et des princes de sottise de la modernité et de l’art contemporain, de préférence avec un marteau ? Nenny.
Il finit par aboutir à un vague exposé de l’art contemporain, dont ne surnage en fait pas grand-chose – et il est certain que 1h30 de conférence ne permet pas de venir à bout d’un si vaste sujet. Clémence rengainée, évaluons le contenu de cette conférence. Que nous dit Michel Onfray sur l’art contemporain ? Quelle lumière celui qui s’est fait profession d’allumer des feux de joie au crépuscule des idoles peut-il apporter ? Va-t-il frapper les statues des idoles inquestionnées et des princes de sottise de la modernité et de l’art contemporain, de préférence avec un marteau ? Nenny.
Que nous dit-il, donc ? D’abord – et cela est juste – qu’on ne peut critiquer que ce que l’on connaît. Mais, que répond-il justement à cet homme du public qui estime qu’« on prend les gens pour des cons » et qui exprime un rejet de connaisseur (il fait référence à Hans Hartung, Bernar Venet, Piero Manzoni, Ben, la FIAC) ? Que répond-il à la légitime interrogation de cet homme qui souligne qu’il n’y a parfois plus rien à quoi se raccrocher dans l’art moderne (ce que Jean-Philippe Domecq nomme « réserve d’effets » intrinsèque à l’œuvre, c’est-à-dire indépendante des amphigouris théoriques) ? Hé bien, tout comme les catéchumènes et évangélistes du milieu de l’art et les musées (étudiants, théoriciens, journalistes, médiateurs…), Onfray répond – à côté de la plaque – puis fait comprendre, à peu près, que son interlocuteur est un béotien qui ne comprend pas : « vous pouvez dire j’aime, j’aime pas, ça me plaît ou ça me plaît pas – il faut avoir de bonnes raisons ». Et toc ! Ou encore : « avant le jugement de goût, il faut une pédagogie et une éducation au jugement de goût ». Et re-toc !
Cela ne manque d’ailleurs pas de saveur, alors qu’il dénonce lui-même les « subversifs officiels » (qu’il ne nomme pas) et le chantage au « vous n’y connaissez rien » : « je pense qu’il y a un discours aujourd’hui élitiste, hyper-élitiste, hyper-aristocratique, très anti-démocratique, de quelques-uns qui veulent conserver l’art contemporain pour eux, qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas dire que l’intérêt dans la production d’une œuvre, c’est qu’elle puisse circuler, faire sens, aider, secouer, ébranler les gens, et qu’on puisse, à partir de telle ou telle œuvre d’art, réfléchir, s’interroger ».
Quoi d’autre ? « La mort de Dieu, au XIXe siècle correspond également à la mort du Beau (…) c’est-à-dire à la mort de cette idée qu’il n’y aurait de l’art que quand il y aurait de la beauté. Si la beauté et la divinité entretiennent un certain type de relation, un certain type d’intimité, il faut bien que, quand l’un meurt, l’autre meure également ». Il faudrait alors s’interroger sur l’œuvre de bien des artistes où la religion entre assez peu en compte, comme, au hasard, dans la majorité de la peinture du Siècle d’Or hollandais, ou bien les œuvres si diverses de Jacques Callot, d’Antoine Watteau ou d’Honoré Daumier… Mais enfin, admettons que même l’art profane, avant la mort de Dieu, fût contaminé par cette sordide exigence de beauté… (Notons, au passage qu’il faut attendre longtemps avant qu’il cite, assez lapidairement, quelques noms… d’ailleurs pas très nombreux… dans l’art contemporain : Maurizio Cattelan, Panamarenko, Wim Delvoye, Raymond Hains, Orlan, Eduardo Kac. Baste !)
Quoi encore ? De même que les inlassables « experts » économistes stipendiés (au hasard : Elie Cohen, Alain Minc, Nicolas Baverez, feu Jacques Marseille, Jacques Attali, etc.) qui à longueur de tribunes et d’émissions de débat vous racontent que si les Français ne veulent pas de réforme ce n’est pas par choix raisonné mais par manque de pédagogie (la pédagogie de la soumission, s’entend), de même Onfray explique qu’il faut de la pédagogie, qu’il faut enseigner l’art contemporain à l’école, le promouvoir dans les villages, avec des cirques itinérants, etc. Comme si cette logique n’était pas déjà à l’œuvre, à travers des foires d’art, à travers le Beaubourg Mobile, à travers les envois de collégiens perplexes dans des « centres d’art » où leurs professeurs sont bien infoutus de dire ce qu’il y a d’artistique dans les artefacts y présentés…
« Ça peut être incompréhensible à la plupart, mais, si on explique, si on raconte, si on est dans la pédagogie, alors je crois qu’on peut comprendre l’art contemporain, l’aimer – ce qui est encore plus intéressant – et puis surtout le juger », dit-il donc. Sauf que, justement, que fait-on quand lorsqu’on se trouve d’autant plus affligé de la nullité que l’on a compris de quoi il en retournait ? On se résout à rejoindre malgré une absence totale d’affinité le camp des vilains réactionnaires ? Ou bien exige-t-on que des critères de jugement soient énoncés, indiqués ? Ne comptez pas sur Onfray, en tout cas, pour vous offrir des rudiments de la « langue » artistique ou tenter d’esquisser une définition de l’art. Au demeurant, pour citer Yves Michaud, l’art est à présent « à l’état gazeux », diffus, insaisissable… indéfinissable, en somme, car les théories de la modernité et de la postmodernité se sont évertuées à dé-définir l’art (Harold Rosenberg).
 Que dit-il encore ? Que l’art contemporain « est une langue qui fait sens quand on l’apprend ». Et, ailleurs, que « l’art contemporain est devenu “archipélique” ». Or, s’il ne donne aucune définition de l’art contemporain, c’est précisément parce que ce n’est pas une langue, mais un archipel de langages – et de langages souvent autistiques, c’est-à-dire parlés par un seul (ce qui exige donc qu’on en passe par son crâne et sa vision et les justifications verbeuses pour approcher le sens arbitraire qu’il a conféré à ce qu’il expose, niant par là-même toute possible communication, toute altérité), selon la notion de « mythologie personnelle » (dont la véritable naissance remonte aux élucubrations théoriques des premiers temps de l’art non-figuratif, mais dont le concept est daté aux années 50), que chacun a sa langue à lui. Kandinsky n’écrivait-il pas dès 1912 : « l’artiste, en général, n’a que peu à dire. Il lui suffit d’une nuance insignifiante pour se faire connaître » ?
Que dit-il encore ? Que l’art contemporain « est une langue qui fait sens quand on l’apprend ». Et, ailleurs, que « l’art contemporain est devenu “archipélique” ». Or, s’il ne donne aucune définition de l’art contemporain, c’est précisément parce que ce n’est pas une langue, mais un archipel de langages – et de langages souvent autistiques, c’est-à-dire parlés par un seul (ce qui exige donc qu’on en passe par son crâne et sa vision et les justifications verbeuses pour approcher le sens arbitraire qu’il a conféré à ce qu’il expose, niant par là-même toute possible communication, toute altérité), selon la notion de « mythologie personnelle » (dont la véritable naissance remonte aux élucubrations théoriques des premiers temps de l’art non-figuratif, mais dont le concept est daté aux années 50), que chacun a sa langue à lui. Kandinsky n’écrivait-il pas dès 1912 : « l’artiste, en général, n’a que peu à dire. Il lui suffit d’une nuance insignifiante pour se faire connaître » ?
De fait, il n’y a pas « une langue » à apprendre qui serait celle de l’art contemporain dans son ensemble et qui aurait des codes communs, puisque la règle, c’est qu’il n’y a pas de règle. Car comment expliquer que les objets aussi divers que ceux de Frank Stella, Donald Judd, Hanne Derboven, les vidéos/performances de Pipilotti Rist ou Marina Abramovic, les transformations chirurgicales d’Orlan ou encore l’exhibitionnisme de Sophie Calle ou de David Nebreda, appartiennent à la même catégorie « Art » que les toiles de Zdzislaw Beksinski, de Zoran Mušic ou de Peter Doig ? Comment, en effet, débattre sur l’art contemporain sans même tenter d’apporter une définition ?
Onfray, enclin à proposer une histoire alternative de la philosophie – d’ailleurs très accessible –, enclin à contester l’enseignement académique ou dominant sur ce terrain-là, que n’applique-t-il cette même approche à l’art moderne et contemporain, qui a aussi son histoire officielle, son académisme… ? (Et ses dessous des cartes : voyez, par exemple, « Quand la CIA infiltrait la culture », ou bien « L’art s’explose »).
Il souhaite « que les gens s’emparent à nouveau de l’art » : « Mon aspiration serait que vous puissiez aller à la FIAC, et qu’à la FIAC vous puissiez librement dire “ça, ça me plaît ; ça, ça ne me plaît pas ; j’aime ceci, j’aime cela”, indépendamment de l’argent ». Or, lorsqu’une personne qui s’en est emparé et lui dit qu’il n’aime pas ceci ou cela, il ne s’attarde pas à examiner la légitimité du rejet et lui applique le même traitement expéditif et commode qu’à Jean Clair ou Régis Debray… qui pourtant soulèvent de pertinentes questions. Déjà en 1979, Bernard Ceysson, à l’occasion d’une exposition sur l’art des années 30 constatait que « tout artiste s’écartant de la voie royale du progressisme avant-gardiste est déclaré passéiste ou académique ». N’est-ce pas aussi bête d’envisager l’histoire de l’art avant tout à l’aune des avant-gardes qu’il le serait d’envisager Mai 68 à travers la révolte estudiantine seulement ?
Il est intéressant de rappeler combien, à travers l’histoire et a fortiori depuis le XVIIe siècle, les disputes intellectuelles ont pu être vives relativement au statut de l’art, son rôle et ses missions, son rapport à la société, son devoir d’édifier, de « plaire et instruire » selon la doctrine classique, ou bien d’armer les esprits selon les conceptions révolutionnaires (entre autres). Or, l’inane respectabilité idolâtre de l’art et de l’artiste, exhaussé et accepté depuis Kandinsky comme prophète (autoproclamé), mérite question. Car, malgré toute cette inepte tradition solipsiste d’un art qui ne s’intéresse qu’à lui-même (et qui représente, tout de même, un sacret paquet de conneries, de Malevitch, Mondrian ou Strzeminski jusqu’à Ad Reinhardt ou Frank Stella, et tout un tas d’avatars du « dernier tableau »), est infiniment plus divers que ce qui apparaît dans nos musées, et dont les générations futures riront sûrement plus encore que des Pompiers du XIXe siècle que par catéchisme bien appris, nous devrions détester sans examen au profit des gentils impressionnistes que tout le monde aime (comment détester ce qui est beau, parfois sublime comme les Nymphéas de l’Orangerie… et vide de propos ?). Et surtout, il est capital de cesser de poser l’art comme un phénomène tout à fait extérieur aux choses de la société, à plus forte raison alors même que depuis un siècle l’un des mots d’ordre n’a cessé d’être « abolir la frontière entre l’art et la vie ». L’art est évidemment questionnable, et pas uniquement pour des raisons internes à l’art, mais aussi en raison de ce qu’il représente, valide, préfigure, amplifie, légitime. Et cela n’a rien à voir avec la censure et la réaction, mais avec le simple et sain débat d’opinions libres en régime démocratique libéral.
Pour énoncer que les critiques de l’art moderne et contemporain sont nécessairement des réactionnaires, il faut ignorer que le communiste René Magritte écrivait que « L’art non figuratif n’a pas plus de sens que l’école non enseignante, que la cuisine non alimentaire, etc. », ou que le révolutionnaire George Grosz dénonçait férocement les billevesées de l’art « pur » et le « romantisme technique du Bauhaus » (entre bien d’autres cibles). Il faut rejeter le scepticisme de personnes guère soupçonnables d’accointances fascisantes ou réactionnaires comme, au hasard, Ernst H. Gombrich, Claude Lévi-Strauss, Michel Leiris, Octavio Paz, Yves Bonnefoy, Cornelius Castoriadis, Hannah Arendt (« La crise de la culture ») ou Roger Caillois (« Picasso, le liquidateur »). Il faut oublier les débats vifs et passionnés sur l’art abstrait, sur le rôle de l’artiste et son engagement, les pertinentes questions philosophiques qui se sont posées tout au long de l’histoire de l’art et qui jamais ne se sont résumées à « réactionnaire ou progressiste », sorte de déclinaison savante de « êtes-vous plutôt slip ou caleçon ? ».
Il s’avère d’ailleurs qu’il y a souvent plus de matière à s’interroger avec les prétendus « réactionnaires » (qui ne le sont pas tous, loin s’en faut) que chez les thuriféraires de l’art contemporain. Exigence de sens, d’intelligibilité, de retour au savoir-faire, interrogation morale (oh ! le catéchumène de gauche crie « au moralisme ! », « au réactionnaire » ! oubliant qu’il a existé une gauche se posant des questions morales : sans remonter à Jaurès, il y avait, par exemple le Mitterrand des années 70, tout comme il y a aujourd’hui Mélenchon).
De tout cela, Michel Onfray ne parle pas – par omission ou par manque de temps ? Sans doute les deux. Or, tout cela mériterait examen, et c’est peu dire.
CD : Michel Onfray, « Faut-il brûler l’art contemporain ? », éd. Frémeaux et Associés, prix indicatif : 25€.








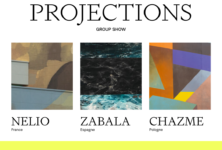





One thought on “Michel Onfray : Faut-il brûler l’art contemporain ?”
Commentaire(s)